
Psychohistoire
La guerre du Golfe, une maladie mentale
par Lloyd deMause*
Cet article est la traduction d’un chapitre du livre “The Gulf War as a Mental Disorder”, in Lloyd deMause, The Emotional Life of Nations, Karnac Books, 2002.
Résumé : La guerre que menèrent les Américains contre l’Irak en 1991 était un rituel sacrificiel – similaire aux rituels des civilisations antiques – destiné à regonfler le moral de la nation. Hypnotisés par le spectacle qu’en donnèrent les chaînes de TV, les citoyens ne remarquèrent même pas qu’ils assistaient à la destruction quasi-apocalyptique de l’Irak
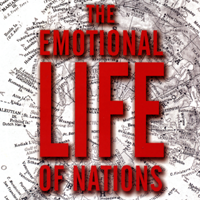
On va lui foutre une fessée !
(George H. W. Bush)
Peu de présidents américains ont été capables de résister à l’appel de la nation en faveur d’une guerre. Des études ont montré que le facteur déterminant est le genre d’enfance qu’ils ont eu[1]. Jimmy Carter a pu compter sur des parents relativement aimants, en particulier une mère qui encouragea l’épanouissement de sa personnalité et son indépendance, une qualité rare chez un parent des années ’20[2]. Ce n’est pas une coïncidence si, en rassemblant toutes les photos d’enfance des présidents américains que je pus trouver, je remarquai que seules celles de Jimmy Carter et Dwight Eisenhower (un autre président qui sut résister à l’appel de la guerre) montraient leur mère qui leur souriait.
Par contraste, l’enfance de Ronald Reagan ressemble à celle de la plupart des présidents : un cauchemar de négligence et d’abus, dominé dans son cas par une mère bigote et un père alcoolique et violent qui, disait-il, le « frappait avec ses bottes » et le « tabassait », lui et son frère[3]. En conséquence, comme je l’ai montré dans mon livre Reagan’s America, son enfance fut remplie de phobies et de terreurs « à la limite de l’hystérie », de sentiments réprimés de rage, et une profonde angoisse de castration (le titre de son autobiographie était Que reste-t-il de moi ?). Devenu adulte, Reagan prit l’habitude de porter un pistolet chargé et envisagea même le suicide, mais il trouva dans la politique une stratégie inconsciente de défense et devint un ardent militant anti-communiste, partant en croisade contre des « ennemis » imaginaires qui furent persécutés pour des sentiments qu’il avait lui-même refoulés[4].
Le style présidentiel de George H. Bush
L’enfance de George H. Bush, bien que moins chaotique que celle de Reagan, fut également remplie de peurs et de châtiments corporels. La psychohistorienne Suzy Kane interviewa le frère de Georges, Prescott, Jr, qui raconte que son père le fessait souvent avec une ceinture ou une lanière de cuir. Lorsqu’il anticipait la punition, il se mettait à « trembler de peur[5] » : « Il nous prenait par-dessus ses genoux et nous rossait avec sa ceinture. Il avait la main lourde. On la sentait passer[6] ! » Prescott, Jr, Bush affirma encore à Kane : « Nous avions tous peur de lui. Nous étions terrorisés à mort par notre père quand nous étions plus jeunes. » Des camarades de classe de Georges décrivaient son père comme « froid et distant, sévère et redoutable, très austère et peu sympathique. » Georges lui-même admit un jour : « Papa était vraiment terrorisant[7]. » En conséquence, l’enfant développa un besoin irrépressible de plaire. En tant que président, il avait une personnalité dépressive et conciliante.
La nation américaine était également déprimée lorsque Georges Bush se présenta aux élections, ce qui favorisa sa victoire sur son concurrent moins déprimé. Dans les années ’80, une décennie souvent faussement qualifiée de « complaisante », l’Amérique avait connu une période de paix et de prospérité fondée sur la spéculation financière et sur des dépenses militaires extravagantes, financées par la dette publique[8]. Comme nous le verrons, ces périodes de type maniaque se résolvent souvent par une guerre. En 1989, néanmoins, l’ennemi traditionnel de l’Amérique, l’URSS, s’était effondré et une période de paix inattendue, sans véritable ennemi, venait de « frapper le monde entier », selon l’expression de Newsweek[9]. Peu après la chute de l’Empire du Mal – c’est ainsi qu’avait été décrite l’Union soviétique –, l’Amérique et l’Europe plongèrent dans une récession économique. Le psychohistorien David Beisel résume l’atmosphère :
« Le New York Times parle d’un “sentiment de vacuité, qui infecte l’Europe de l’Est”. Un commentateur bien informé sur la situation anglaise constate que les Anglais traversent “une période de doute et d’humiliation, comme ils n’en ont jamais connue depuis trente ans”. La couverture du World Press Review parle du “blues de la réunification allemande”. L’Europe est déprimée. Seulement trois ans auparavant, les Allemands “étaient en transe dans les jours qui précédèrent et qui suivirent la réunification”, disait Current History. “Deux mois plus tard, l’euphorie s’était assombrie”[10]. »
L’Amérique aussi se sentait terriblement mal après la chute du Mur de Berlin. « La démocratie est victorieuse, écrivait le New York Times le 4 mars 1990, la course aux armements est terminée. Les méchants sont devenus gentils, l’Amérique a touché le jackpot. Alors pourquoi est-ce qu’on ne se sent pas mieux[11] ? » Partout on prédisait la ruine, le déclin et la mort du Rêve américain. Les médias se demandaient pourquoi, malgré le fait que la paix mondiale était atteinte et que l’économie américaine se portait bien, « les gens sont incroyablement déprimés » (The New York Times) ou que « ces derniers mois, il y a une odeur distincte d’effondrement et de ruine en ville » (New York Post) et en concluaient que « quelque chose de catastrophique est sur le point de se produire[12] ». (Washington Post). Sans ennemi extérieur sur lequel projeter ses peurs, l’Amérique n’avait d’autre choix que de provoquer une récession économique de type sacrificiel pour sortir de sa dépression, s’infligeant ainsi une punition comme prix de la paix et de la prospérité.
Une des raisons qui favorisèrent la victoire électorale de Georges Bush fut sa conviction souvent affirmée que « nous devons tous faire des sacrifices[13] ». Tandis que l’économie continuait à progresser en 1989 et 1990, il réalisa inconsciemment qu’il devait faire quelque chose de dramatique pour arrêter cette expansion, afin que les gens cessent de consommer et provoquent une récession qu’ils puissent ressentir comme une punition. Son propre moral était affecté par les messages culpabilisants des médias, autant que par sa consommation d’Halcion, un psychotrope qui peut rendre le consommateur si maniaco-dépressif qu’il en devient suicidaire[14].
La potion que Bush administra à l’Amérique fut d’augmenter les impôts, de tailler dans les dépenses publiques et de s’opposer à toute législation allant dans le sens d’une reprise économique. Bien qu’il sache qu’une augmentation d’impôts le rendrait impopulaire[15] et violerait ses engagements préélectoraux (« Lisez sur mes lèvres : pas d’impôts supplémentaires » avait-il assuré dans son discours d’investiture, en 1988), il allait donner à l’Amérique la punition qu’elle demandait à un niveau inconscient plus profond. Il apparut vite que les recettes publiques seraient globalement moins importantes que si les impôts étaient restés inchangés[16], prouvant que l’objectif inconscient était bien de provoquer une récession – et non une augmentation des recettes fiscale – perçue comme nécessaire pour « nettoyer la pourriture du système », comme l’expliqua un haut fonctionnaire de l’administration Bush[17].
La paix, la prospérité et la pollution.
Depuis que Freud a pour la première fois étudié des cas de patients « ruinés par le succès[18] », les psychothérapeutes ont souvent observé que le succès personnel et la prospérité font resurgir chez les personnes des sentiments de culpabilité et d’illégitimité. Pourtant, personne ne semble avoir remarqué que ce genre de sentiments culminent dans la vie émotionnelle d’une nation après une longue période de paix, de prospérité et de progrès social, particulièrement si cette dernière fut accompagnée de plus de liberté personnelle et sexuelle[19]. Dès 1988, des leaders politiques et économiques américains s’étaient demandé si la prospérité des années Reagan n’avait pas assez duré, et certains envisageaient une récession comme salutaire. La Federal Reserve Bank, satisfaite qu’une première augmentation des taux d’intérêt durant l’été 1987 ait provoqué la baisse journalière la plus brutale dans toute l’histoire de la bourse, resserra encore ses taux durant l’été 1988 afin d’accélérer ce processus, justifiant cette mesure par l’idée qu’il fallait « refroidir l’économie » – une manière codée de parler de réduire la culpabilité pour tant de succès. Décrivant cette stratégie, un journaliste perspicace avait fait ce commentaire en 1988 : « Après les élections, le gouvernement dira à la Fed, “Allez-y les gars, resserrez [les crédits] !” La Federal Reserve le fera, les taux d’intérêt augmenteront et l’économie ralentira. Alors, ils diront au prochain président d’augmenter les impôts. Cela m’effraye[20]. »
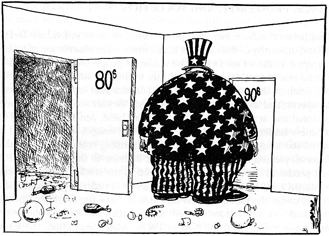
Fig. 1 : L’Amérique se sentait coupable et déprimée après la prospérité des années 1980.
Comme je l’ai montré dans mes travaux précédents[21], le sentiment national de culpabilité est généralement représenté dans les caricatures politiques comme une pollution. Chaque fois qu’une nation se sent plus prospère que son enfance déshéritée ne peut tolérer, elle imagine que c’est un péché et une « alerte à la pollution » est lancée au niveau national, c’est-à-dire une croisade puritaine dans laquelle les médias remarquent soudain qu’il existe des choses comme la pollution atmosphérique (pluies acides), domestique (dioxine) ou sanguine (sida) – qui toutes existaient auparavant, mais deviennent subitement des symboles d’un fantasme de pollution intérieure (péché, culpabilité, orgueil) qui doit être purifié. Durant ces croisades puritaines à caractère émotionnel, les médias cessent de minimiser les dangers existants et lancent des appels hystériques en prétendant que le monde est devenu soudainement invivable, et évitent ensuite de changer quoi que ce soit – puisque la pollution qui effraye la nation est en réalité intérieure, et non extérieure.
En 1988-89, le rôle de la communauté bancaire dans ce que les médias allaient appeler « la crise qu’il nous faut[22] » fut de réduire l’offre monétaire, d’augmenter les taux d’intérêts et de réduire le crédit. La Federal Reserve Bank annonça qu’elle voulait réduire l’inflation « proche de zéro », un objectif qui n’avait jamais été atteint par aucune nation sans être accompagné en retour d’une dépression. Le rôle de la Federal Reserve Bank dans ce sens avait été révélé plus tôt par son directeur Paul Volcker qui, essayant de faire une plaisanterie, avait affirmé à un journaliste : « Nous avons la peur panique que quelqu’un, quelque part puisse être heureux[23]. »

Fig. 2 : L’Amérique se sentait « polluée » en 1988.
Plusieurs journalistes reconnurent l’origine dépressive de l’humeur nationale et même le sentiment de culpabilité qui l’engendrait. Le Washington Post affirma que, après huit ans d’optimisme, « l’Amérique est dans un accès répugnant de culpabilité, de terreur et de nostalgie. Une fois de plus, l’Amérique est déprimée[24] ». Un éditorialiste diagnostiqua précisément l’humeur de l’Amérique en 1990 :
« L’Amérique est comme un ivrogne de bistrot. Un moment il se vante de son argent et de sa force, et pendant l’heure qui suit il se lamente de ses échecs et de son impuissance... La dépression de l’Amérique n’est pas le résultat d’une peste, d’un déluge, d’une famine ou d’une guerre... Nous nous sentons coupables, coupables, coupables... dépression, déclin, dépravation, dysphorie, déconstruction, désuétude, désoeuvrement, défiance, drogues, désespoir[25]… »
Il y avait une seule façon d’éviter qu’une longue récession économique ne soit nécessaire pour guérir la nation de sa dépression. Il fallait fabriquer un ennemi extérieur qui puisse porter le blâme de notre « cupidité » collective et être ensuite puni à la place de l’Amérique.
À priori, l’idée que l’Amérique puisse s’engager dans une guerre pour des raisons émotionnelles semble blasphématoire. Bien que la plupart des gens conviennent que les actes homicides commis par un individu puissent prendre leur source dans un désordre émotionnel inconscient, il est plus rare que l’on se demande si les guerres – qui sont des actes homicides commis par des nations entières – puissent venir de désordres émotionnels vécus collectivement. Sauf si elles sont mises sur le compte des problèmes psychologiques d’un leader, comme dans le cas de Hitler, les guerres sont généralement expliquées par des motivations économiques. Mais si les nations faisaient la guerre par utilitarisme, on devrait pouvoir trouver dans les paroles et les actes des leaders qui s’apprêtent à entrer en guerre des discussions présentant les bénéfices économiques d’une telle entreprise. C’est pourtant exactement ce qui manque dans les documents historiques. Au lieu de cela, les guerres démarrent généralement sur des images paranoïaques, homicides ou même suicidaires. Par exemple, lorsque le gouvernement japonais se demanda s’il fallait attaquer Pearl Harbor et entrer en guerre contre les États-Unis, le général Hideki Tojo demanda à plusieurs ministres ce qui se passerait s’ils s’en prenaient à l’Amérique. Lors d’une réunion, chaque ministre présent pronostiqua une défaite japonaise et lorsque le dernier d’entre eux donna son avis, il était clair qu’une telle attaque était suicidaire. C’est alors que Tojo leur adressa ces paroles : « Il y a des moments où l’on doit avoir le courage de faire des choses extraordinaire – comme sauter, les yeux clos, depuis la véranda du Temple de Kiyomizu ! [C’est le temple de Tokyo où des gens se suicident régulièrement][26] » Hitler lui aussi s’exprima en termes suicidaires et non économiques lorsqu’il partit en guerre[27], promettant aux Allemands une mort glorieuse sur le champ de bataille et parlant de lui comme d’un « somnambule » tandis qu’il conduisait le peuple allemand par-dessus la falaise suicidaire.
Les faits historiques suggèrent pourtant que des motivations fortement irrationnelles expliquent l’intervention américaine dans le Golfe, en 1991. Pour commencer, Bush avait précédemment fait un « ballon d’essai » en envoyant 25’000 soldats au Panama, en prétextant y déloger le dictateur Noriega pour son rôle dans le trafic de drogue. Bien que cette opération embarrassât l’armée, qui la qualifia de ridicule parce que « toute cette foutue opération revient à trouver un seul gars dans un bunker[28] » les Américains adorèrent le spectacle, la popularité de Bush augmenta et permission lui fut donnée de poursuivre d’autres actions militaires.
Mais il fallait éviter à tout prix la culpabilité de démarrer la guerre, tout en la préparant. Même Hitler pensa nécessaire de déguiser quelques-uns de ses soldats avec des uniformes polonais et leur fit attaquer des Allemands de sorte qu’il puisse trouver un prétexte à son attaque de la Pologne. Dans l’esprit des Américains, leur pays n’a jamais attaqué un adversaire de toute son histoire. Il s’est seulement défendu ou a porté secours à d’autres pays en difficulté. Tandis qu’en 1990, la dépression nationale s’intensifiait, le défi de Bush fut de trouver quelqu’un qui soit disposé à attaquer un pays plus faible, afin que l’Amérique puisse venir en sauveur et redonner aux Américains le sentiment de puissance qu’ils avaient perdu.
Sacrifices d’enfants.
Dans les mois qui précédèrent la crise du Golfe, les magazines américains – à travers images et caricatures – commencèrent à exprimer des désirs de mort à l’égard de la jeunesse, suggérant inconsciemment un sacrifice. Des enfants étaient dessinés poignardés, fusillés, étranglés ou jetés du haut d’une falaise. Ce genre de représentations subliminales peut être qualifié de fantasme collectif, du type de ceux qui précèdent une guerre. Ces images étaient identiques aux pratiques bien réelles de l’Antiquité au cours desquelles des enfants étaient sacrifiés en masse pour apaiser les dieux et expier les péchés de la communauté[29]. Par exemple, le magazine Money, illustrant un reportage sur les facilités d’entrée aux universités, utilisa en couverture le dessin d’un jeune homme agressé par des drapeaux, avec comme commentaire : « Le sacrifice des enfants ». En l’occurrence, l’illustration était en contradiction avec le contenu de l’article, mais correspondait au fantasme ambiant. Des images d’enfants tués dans des « banlieues en guerre » faisaient la une des journaux et des magazines, bien que la criminalité ait en fait baissé au cours des dix années précédentes[30]. Un sommet de l’ONU sur les droits de l’enfant fut illustré par une caricature montrant le président Bush qui voulait électrocuter les enfants américains parce qu’ils n’étaient pas sages.
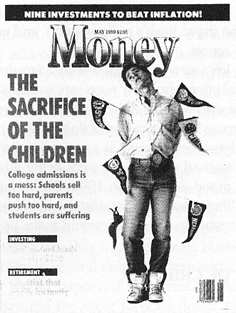
Fig. 3 : Des suggestions de sacrifice d’enfants avant la crise du Golfe.

Fig. 4 : Les enfants étaient perçus comme tellement désobéissants qu’ils méritaient l’électrocution.
Il devint particulièrement clair que c’était la mort d’une partie « mauvaise » de nous-mêmes qui était suggérée lorsque, début 1990, les médias se focalisèrent sur l’histoire d’un médecin – un militant de longue date pour la légalisation du suicide assisté – qui avait construit une « machine à suicide » conçue pour administrer une dose létale de poison. Une caricature montra même le président Bush en « docteur suicide » suggérant qu’il aiderait la nation américaine à se suicider. Le moral de la nation touchait le fond. Pendant vingt années, j’avais rassemblé plus de 100’000 caricatures sans jamais tomber sur un dessin montrant un président sur le point de tuer ses concitoyens.
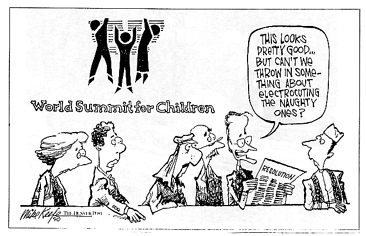
Fig. 5 : Bush dans la peau d’un « docteur suicide ».
Le spectre de la mère terrifiante.
Lorsqu’un patient est hospitalisé en clinique psychiatrique avec une dépression sévère qui n’est pas directement en lien avec sa vie quotidienne et qu’il fait état de rêves d’enfants blessés ou de pensées suicidaires, le psychiatre pense à un diagnostic de stress post-traumatique (Post-traumatic Stress Disorder ou PTSD). C’est particulièrement vrai si – comme l’Amérique en 1990 – le patient souffre d’accès de panique, de peurs exagérées face au futur, de comportements d’achat ou d’emprunt compulsifs, d’abus de drogue ou de sentiments d’irréalité et de détachement. Comme ce sont tous des symptômes d’un stress post-traumatique, l’une des premières questions que le psychiatre lui posera sera de savoir si ce patient a vécu des « flash-backs » de traumatismes d’enfance, en particulier des images intrusives de figures parentales effrayantes, et particulièrement de figures maternelles cruelles et négligentes. Lorsque ces images fantasmatiques se généralisent – comme c’est le cas dans les périodes qui précèdent les guerres – elles indiquent que la nation traverse un stress post-traumatique, qui cherchera vraisemblablement une issue par la projection de ces peurs sur l’image d’un ennemi.
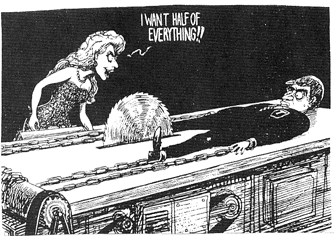
Fig. 6 : Des figures de Mères terrifiantes apparurent dans les médias.
Durant les mois qui précédèrent la crise du Golfe, les médias montrèrent quantité d’images de femmes effrayantes. Une Madonna castratrice et râleuse faisait la couverture des magazines. Ivanna Trump, la femme d’un richissime magnat de l’immobilier, apparut en couverture comme ayant castré son époux infidèle. Des douzaines de films très populaires – comme Fatal Attraction – mettaient en scène des femmes à la fois séduisantes et meurtrières[31]. Ces images de mères terrifiantes, castratrices et envahissantes, ainsi que des suggestions subliminales de sacrifice d’enfants étaient si répandues dans les médias que je publiai un article, intitulé “It’s Time to Sacrifice… Our Children”, qui mettait en évidence le désir secret de l’Amérique de sacrifier sa jeunesse et prédisait que de nouvelles aventures militaires pourraient bien être entreprises dans le dessein inconscient d’accomplir ce sacrifice[32]. Cet article, écrit quatre mois avant que l’Irak n’envahisse le Koweit, disait :
« Des suggestions subliminales de sacrifices d’enfants ont été exceptionnellement nombreuses dans les médias américains, cette dernière année. À l’Institut de Psychohistoire, nous analysons minutieusement les représentations que fournissent les caricatures politiques et les couvertures de magazines, afin d’obtenir des indices nous permettant de mettre à jour les fantasmes collectifs qui animent la nation. Nous avons découvert un accroissement d’images d’enfants tués, frappés, étranglés, poussés du haut d’une falaise et – plus généralement – punis pour les péchés de leurs aînés.
« Selon nous, ces images sont des « ballons d’essai » qui testent les décisions que la nation pourrait bientôt prendre, mais qui sont déconnectées de notre conscience parce qu’elles choquent notre sens de la morale. En fait, nous avons réalisé que ces représentations médiatiques étaient pour la nation une manière de partager ses fantasmes émotionnels les plus puissants. Elles ressemblent aux rêves répétitifs qu’une personne peut faire dans son sommeil – par exemple, une série de rêves que le conjoint pourrait mourir – et s’apparentent à des motivations profondément refoulées.
« Lorsque ce genre d’images prolifèrent dans les médias, cela signifie que nous lançons des signaux subliminaux qui suggèrent qu’il est peut-être temps de faire payer à nos enfants les excès dont nous nous sommes rendus coupables au cours de la récente Décennie de la Complaisance. »
À l’époque, je ne pouvais imaginer qui serait notre nouvel ennemi, dans la prochaine guerre sacrificielle faisant suite à l’effondrement de l’Empire du Mal.
À la recherche d’un nouvel ennemi.
Le président Bush dut réaliser que ces messages inconscients lui commandaient d’entrer en guerre. Sa virilité fut mise en doute lorsque des dessinateurs l’affublèrent d’une jupe et que les médias commencèrent à le décrire comme une « tante ». Des caricatures le montrèrent bientôt attaqué et dévoré par des montres[33]. Il sentit la détresse rageuse de la nation et réalisa qu’il devait faire quelque chose rapidement. Dans ce monde de l’après-guerre froide, soudain si paisible, où pouvait-il trouver un ennemi assez fou pour défier l’armée la plus puissante de la planète, et suffisamment petit pour que nous puissions le battre facilement ?
En tant que leader de la nation, auquel nous déléguons inconsciemment la tâche de trouver l’ennemi nécessaire au bon moment, il ne fut pas pris au dépourvu. Le leader irakien, Saddam Hussein, avait depuis longtemps été entretenu par les États-Unis. En 1986, alors vice-président, Bush l’avait personnellement contacté pour favoriser secrètement une escalade de la guerre contre l’Iran[34]. L’Amérique avait alors illégalement contribué à l’armement – y compris nucléaire – de l’Irak, pendant plus de dix ans, et accordé des garanties par milliards qu’elle avait fini par payer elle-même[35]. Les livraisons d’armes vers l’Irak, l’argent versé à l’Irak en passant par des banques italiennes, l’approbation officielle des exportations d’équipement militaire et même l’envoi de nos stocks d’armement de l’OTAN depuis l’Allemagne faisaient partie d’une stratégie clandestine, entièrement illégale, couverte par l’administration Reagan[36]. Pour sa part, l’Irak se sentait redevable envers les États-Unis. Comme l’a très bien montré Kenneth Timmerman dans son livre The Death Lobby : How the West Armed Iraq : « L’armement de l’Irak est une histoire d’amour qui a duré quinze ans [pour l’Amérique]. Saddam Hussein est notre création, notre monstre. Nous l’avons construit et avons ensuite cherché à le détruire[37]. »
Comme tant de dictateurs, Saddam Hussein a eu une enfance incroyablement traumatique[38]. Sa mère aurait essayé de l’avorter en frappant son abdomen avec ses poings et en s’entaillant avec un couteau de cuisine, s’écriant : « Je porte le diable dans mon ventre. » L’enfant fut élevé par son oncle, un homme violent qui le battait régulièrement, le traitait de « fils de bâtard » et l’entraînait à se servir d’une arme et à voler des moutons. Saddam commit son premier homicide à l’âge de 11 ans. Sa carrière politique fut tournée vers l’assassinat de ses concitoyens. Il appréciait particulièrement le spectacle de la torture et de l’exécution des officiers qui avaient combattu à ses côtés. Saddam était manifestement l’ennemi idéal auquel l’Amérique pourrait déléguer la tâche de démarrer une nouvelle guerre.
Début 1990, avant que la crise du Golfe ne démarre, l’armée américaine s’entraîna à quatre reprises avec pour cible virtuelle l’Irak, faisant suite à une invasion virtuelle du Koweit[39]. Au même moment, les dirigeants koweïtiens adoptèrent soudain une attitude de provocation à l’égard de l’Irak, refusant de discuter de questions essentielles relatives à des territoires et à des prêts contestés, ce que même le roi Hussein de Jordanie qualifia d’« inexplicable[40] ». À ce sujet, un expert du Moyen-Orient affirma que « si les Américains n’avaient pas encouragé cette attitude, la famille royale [du Koweit] n’aurait jamais pris l’initiative de provoquer Saddam[41] ». De plus, les États-Unis fournirent encore 3 milliards de dollars de « prêts agricoles » à Saddam, qu’il s’empressa d’utiliser à des fins militaires.
Un rapport spécial d’investigation, basé sur des documents exfiltrés et publié par le London Observer mais ignoré du reste du monde, révéla que début 1990 Bush avait secrètement envoyé un émissaire pour rencontrer l’un des proches de Saddam Hussein. Selon un résumé de ce rapport[42], « l’émissaire dit au confident du dictateur que “l’Irak devrait trouver le moyen d’accroître ses revenus du pétrole, afin de sortir son pays de ses ennuis économiques chroniques.” Hussein prit ce conseil à la lettre et concentra des troupes sur la frontière du Koweit. À l’évidence, la complicité américaine alla beaucoup plus loin qu’un simple mauvais calcul sur les intentions du leader irakien [et inclut] un support actif du président irakien » dans sa menace militaire envers le Koweit. Les preuves que les États-Unis finançaient, armaient et encourageaient l’aventure militaire agressive de Saddam étaient si évidentes qu’Al Gore, lorsqu’il fut candidat à la vice-présidence en 1992, déclara : « Bush aimerait que le peuple américain le voie en héros, capable d’éteindre un brasier infernal. Mais à l’évidence, c’est lui qui a mis le feu aux poudres. Il a non seulement frotté l’allumette, mais également versé de l’essence sur les flammes[43]. »
Saddam Hussein réagit de façon prévisible aux suggestions américaines. Il menaça publiquement le Koweit et rassembla ses troupes à la frontière. Pour être certain du soutien américain, il convoqua l’ambassadrice américaine April Glaspie à son bureau et lui demanda quelle était la position de Washington sur son litige avec le Koweit. Se basant sur un télégramme reçu la veille du président Bush, Glaspie lui donna ce blanc-seing à peine voilé : « Le président m’a donné ordre d’élargir et d’approfondir nos relations avec l’Irak » et de l’assurer des sympathies américaines concernant ses difficultés. Elle ajouta : « Nous n’avons pas de position sur les conflits arabo-arabes, comme votre différend frontalier avec le Koweit[44]. » Certains officiels du Pentagone affirmèrent ouvertement que ce télégramme serait interprété par Saddam Hussein comme un soutien à une intervention militaire contre le Koweit[45]. « C’est dégoûtant », dit l’un d’entre eux à ce propos.
Au cas où il y aurait un quelconque doute sur les intentions américaines, voici les réponses de l’assistant du Secrétaire d’État John Kelly aux questions posées lors des audiences publiques d’une sous-commission de la Chambre des députés, le 31 juillet 1990, après que les forces irakiennes eurent transporté du carburant et des munitions vers les unités militaires stationnées sur la frontière koweitienne : « Si l’Irak traversait la frontière koweitienne, pour une quelconque raison, quelle serait notre position en regard de l’usage des forces militaires américaines ? » Kelly déclara tout d’abord : « Je ne peux pas entrer dans de telles conjectures. » Puis, comme le député insistait en demandant « Est-ce correct de dire, néanmoins, que nous n’avons pas de traité nous obligeant à engager les forces américaines ? » Kelly répliqua : « C’est correct[46]. » Pourtant, depuis presque un an, le général Norman Schwarzkopf planifiait et entraînait par simulation une attaque américaine massive dans l’éventualité d’une invasion irakienne du Koweit[47]. Malgré cela, le signal implicite fut donné à Saddam qu’une attaque du Koweit ne serait pas prise en compte par les États-Unis. Le 2 août 1990, l’Irak envahissait le Koweit.
La guerre du Golfe est une rejouement traumatique.
Parce qu’il faut un certain temps pour que les fantasmes inconscients se connectent avec la réalité, l’invasion irakienne fut à peine mentionnée par la presse américaine. Le jour même, le Washington Post en fit mention sans émotion, dans une simple colonne de la partie inférieure d’une de ses pages. Le président Bush mit lui-même quelques jours avant de saisir l’opportunité que Hussein lui présentait et ne vit de prime abord aucune urgence à intervenir, affirmant par exemple : « Nous ne discutons pas d’une éventuelle intervention. Ce n’est pas dans mes projets[48]. » Mais, le lendemain, lors d’une rencontre avec le Premier ministre anglais Margaret Thatcher à Aspen, Colorado, il réalisa qu’on attendait de lui qu’il fasse de l’invasion irakienne une guerre américaine. Thatcher lui dit qu’il était Churchill, que Saddam était Hitler et que le Koweit était la Tchécoslovaquie[49]. Après que Mme Thatcher eut dit à Bush que Saddam était « diabolique », celui-ci changea d’avis, comme le déclara un conseiller de Thatcher : « Le Premier ministre est parvenu à lui transplanter la moelle épinière[50]. » Bush déclara abruptement à la TV que l’Amérique devait « se dresser contre le Mal » et qu’il ne devait y avoir « absolument aucune négociation avec l’Irak. » Puis il envoya des troupes et des avions vers le Moyen-Orient.
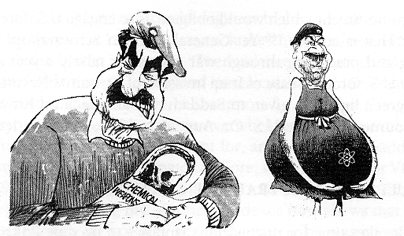
Fig. 7 : Saddam Hussein dans le rôle d’une Mère terrifiante.
L’Amérique s’en trouva revigorée, ayant à nouveau un ennemi pour combattre sa dépression. « Cela fait des mois que nous déprimons, dit un commentateur, et soudain nous avons un nouveau but... Les Américains aiment l’action[51]. » The New Republic approuva en disant « Saddam Hussein a fait au monde la faveur d’envahir le Koweit » puisqu’il nous permettait de sortir de notre dépression[52]. « Merci Saddam, nous avions besoin de cela » titrait encore un autre journaliste[53]. Nos émotions refoulées comme dans un tourbillon, nous allions pouvoir mettre sur pied une Tempête du Désert afin de mettre en actes nos terreurs et notre rage.
Pour justifier la guerre, le président Bush fut aussi changeant que les sables du désert, disant d’abord que c’était « notre travail », puis « notre façon de vivre » et enfin « notre liberté[54] ». La vraie raison était psychologique et inconsciente : en faisant la guerre à l’Irak, l’Amérique pensait pouvoir se guérir de sa dépression, de ses flash-backs de mères terrifiantes liées aux traumatismes de l’enfance, en infligeant à d’autres enfants la punition qu’elle pensait mériter.
Dès le début, les enfants furent l’enjeu véritable de la guerre du Golfe. Tandis que les images de figures maternelles terrifiantes et punitives disparurent totalement des médias, Saddam Hussein devint le parent abusif sur lequel l’Amérique projeta ses fantasmes et il devint la mère terrifiante, l’abuseur d’enfants qui aimait tuer les enfants. La guerre allait-elle être vécue comme une agression fantasmatique contre... une mère ?
Le thème du « tueur d’enfants » fut largement exploité par les médias. Une histoire totalement inventée, mais convaincante, défraya la chronique. Une jeune fille de 15 ans témoigna devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies et le Congrès Américain qu’un chirurgien au Koweit aurait vu des soldats iraquiens sortir des centaines de bébés prématurés hors de leurs couveuses, « les laissant mourir sur le sol glacé[55] ». Aucun de ceux qui entendirent cette histoire invraisemblable lors des audiences du Congrès, ni aucun des centaines de journalistes qui en firent leurs gros titres ne prit la peine de vérifier l’information, puisqu’elle confirmait les fantasmes inconscients de la nation. Ce n’est qu’après la guerre qu’on révéla que le « chirurgien » et la jeune fille avaient utilisé une fausse identité, que cette dernière était la fille de l’ambassadeur koweitien aux États-Unis – une information que les organisateurs du meeting connaissaient – et que cette histoire était totalement inventée, comme d’autres histoires de viols collectifs et de tortures perpétrés par les Irakiens[56]. Mais nous avions besoin d’histoires faisant état de maltraitances d’enfants. Nous étions sur le point de rejouer nos traumatismes d’enfant, exactement comme les patients souffrant de stress post-traumatique blessent souvent leurs enfants, ou eux-mêmes, pour se soulager temporairement de leurs souffrances. Pour cette raison, nous devions donner à nos fantasmes de mères terrifiantes et d’enfants agressés une réalité suffisante pour motiver une nouvelle guerre.
La guerre, un rituel de renaissance.
La guerre du Golfe ne fut pas la seule occasion où l’Amérique se créa un ennemi afin d’engager un combat contre lui. Ce pays a une longue histoire de guerre contre des dictateurs qu’il a préalablement armés[57]. Le but inconscient – comme dans les civilisations antiques – était de s’offrir une renaissance par le combat, dans des périodes où les nations se sentaient dépressives et « polluées », et organisaient des batailles destinées à se « purifier » pour « renaître » de leurs péchés[58]. Les Aztèques, par exemple, décidaient périodiquement qu’ils étaient « pollués » et mettaient sur pied une « Guerre des Fleurs », divisant leurs propres armées en deux camps opposés et s’affrontant dans une bataille mythique destinée à revitaliser le pays. Durant ces combats rituels, ils massacraient des milliers de guerriers pour assouvir la soif sanguinaire de leur déesse – une version primitive de la mère terrifiante – mais s’en prenaient également aux vainqueurs, dont ils arrachaient le cœur dans un rituel de sacrifice à la déesse[59].
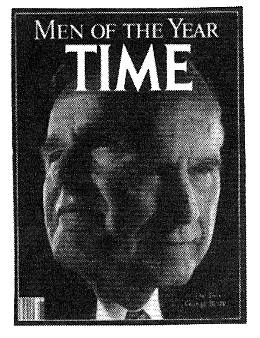
Fig. 8 : George H. Bush et son double, un leader à la fois fort et faible.
Dans l’Antiquité, les guerres commençaient fréquemment par un rituel d’humiliation au cours duquel le leader rejouait publiquement les humiliation subies par les enfants. Par exemple, le roi de Babylone était giflé, forcé de s’agenouiller devant une image sacrée et de confesser ses péchés[60]. En Amérique, quelques mois avant la guerre du Golfe, le président Bush fut également humilié par les médias qui le traitèrent de « tante » (le caricaturiste Pat Oliphant le dessinait avec un sac à main accroché à un poignet ramolli) avant qu’il ne puisse retrouver sa virilité en déclarant la guerre à l’Irak. Fin 1989, le magazine Time montra même deux George Bush, l’un fort et l’autre faible – une projection des deux moitiés de notre propre cerveau, l’un fort, l’autre faible[61]. Cet artifice était également utilisé par les sociétés primitives, qui désignaient un « double » de leur roi avant les guerres pour représenter sa face la plus faible et illustrer le double aspect – fort et faible – de sa personnalité[62].
Ainsi, le rituel sacrificiel de la guerre comprenait trois éléments principaux :
- Un monde pollué et rempli de péchés, avec un leader ressenti comme de plus en plus impotent, c’est-à-dire incapable de contenir les sentiments de dépression et de rage de la nation.
- Des fantasmes de mères terrifiantes, avec des images de déesses en colère qui menacent de dévorer le pays à moins qu’une victime expiatoire ne soit sacrifiée.
- Des enfants sacrifiés, dont le sang revitalisera la vie émotionnelle de la nation et qui représentent en fait notre propre « enfant coupable », celui qui fut la victime des traumatismes originels.
Les éléments correspondant aux traumatismes de l’enfance peuvent être mis en évidence dans le rejouement de la guerre du Golfe. Comme Bush avait été brutalement fessé par son propre père, il menaça de « botter le cul » de Saddam Hussein. De nombreux Américains qui, vraisemblablement, avaient subi le même outrage en tant qu’enfants[63], se mirent à brandir des drapeaux ou à porter des T-shirts avec l’inscription « Botte-cul ». Certains confièrent aux journalistes qu’ils voulaient « fouetter le derrière de Saddam » ou « lui baisser les culottes ». Une caricature montra le siège de l’ONU avec cette inscription : « Un pied dans le cul[64]. »
De son côté, Saddam Hussein vécu également l’imminence de la guerre comme un rejouement des traumatismes d’enfance subis par lui-même et par ses compatriotes. Par exemple, la plupart des garçons irakiens subissent une circoncision sanglante et terrifiante vers l’âge de six ans. Hussein employa des métaphores qui reflètent la peur d’une castration symbolique, affirmant qu’il était du devoir de l’Irak de « ramener la branche [le Koweit] à son tronc [l’Irak] » et menaçant les États-Unis de les faire « nager dans leur propre sang[65] ». Sa mission, disait-il, était de rendre à l’Irak « la partie qui avait été coupée par les ciseaux anglais[66] ».
Les deux nations virent cette guerre comme un combat sacré entre le Bien et le Mal. L’Irak dit que les Américains avaient « désacralisé La Mecque » et que la guerre allait « purifier nos âmes » dans une « confrontation entre le Bien et le Mal[67] ». Le député du Congrès américain Stephen Solarz, exhortant les partisans de la guerre lors du vote qui devait décider de l’invasion, dit : « Il y a le Mal dans le monde[68]. » Le conflit n’était certainement pas une question économique ; les États-Unis dépensent 50 milliards de dollars par an pour maintenir une présence militaire dans le Golfe persique, alors qu’ils n’importent que l’équivalent de dix milliards de dollars de cette région[69]. Ce n’était pas non plus une question politique ; les États-Unis ont toujours refusé de rencontrer le gouvernement démocratique irakien en exil. La guerre et l’embargo n’avaient que des motivations à caractère émotionnel. Comme la plupart des nations modernes, l’Amérique est entrée en guerre tous les vingt ans environ, et vingt ans s’étaient écoulés depuis la guerre du Vietnam. Comme la guerre est une dépendance, un désordre émotionnel, l’Amérique devait se donner une nouvelle guerre pour se purifier de sentiments de culpabilité et d’anxiété liés aux progrès et à la prospérité des années ’80, et Saddam était un ennemi consentant qui pourrait nous procurer ce sentiment d’être purifié, de renaître.
Bush déclara qu’il combattait pour un « Nouvel Ordre Mondial » qui produirait une « ère nouvelle de paix » partout dans le monde. Des Américains interrogés avant l’invasion dirent aux journalistes : « Le cours de l’histoire est en train de changer... Je ne sais pas exactement ce que cela signifie, mais je sais que les choses seront désormais différentes... Le pays a franchi un seuil... Ce genre d’évènement marque la fin d’une époque et le début d’une nouvelle ère[70]. » Comme les sociétés antiques, l’Amérique avait ce fantasme que le monde allait renaître à travers un sacrifice humain.

Fig. 9 : L’Amérique se sentait renaître du fait de la guerre.
Comme les rituels sacrificiels sont dictés par Dieu – l’expression de messages émotionnels inconscients émanant du peuple – ils prennent une forme compulsive et sont perçus comme inévitables, échappant même des mains de ceux qui les organisent. Bien que plusieurs officiels américains ayant bénéficié d’une enfance plus heureuse – y compris Jimmy Carter et le général Colin Powell[71] – pensaient que l’on devait laisser les sanctions économiques produire leurs effets avant de lancer la guerre, Bush rejeta une proposition du soviétique Mikhail Gorbatchev et de Saddam dans laquelle l’Irak acceptait de retirer ses troupes du Koweit si une conférence était organisée dans le but de résoudre les questions litigieuses[72]. Mais Bush avait pour mission de procurer une guerre à ses concitoyens, et non pas seulement d’obtenir de l’Irak qu’il retire ses troupes du Koweit. Lorsqu’il entendit la proposition irakienne de retrait pacifique, il dit : « Au lieu de me sentir dans l’allégresse, mon coeur se serra[73]. » Il dit au secrétaire d’État James Baker III, qui l’invitait à négocier un retrait pacifique avec l’Irak, qu’il ne fallait pas penser à la paix en affirmant : « Nous avons besoin d’une guerre[74]. » Même lorsque Powell lui dit qu’il préférait un retrait pacifique négocié parce que cela sauverait des vies américaines, Bush refusa de l’autoriser[75]. La nation lui avait délégué la tâche d’entrer en guerre, maintenant. « Cette guerre a un caractère inévitable », dit-il encore en ordonnant l’invasion à un demi-million d’hommes et de femmes.
L’Amérique commença par larguer 88’000 tonnes de bombes sur l’Irak, dont 70 % manquèrent leurs cibles militaires et tuèrent des civils[76]. La télévision fournit l’impression qu’il ne s’agissait que de bombes « propres ». Des explosifs aériens illégaux – que la presse américaine craignait voir utilisés par Saddam contre des Américains – furent employés exclusivement et largement par les troupes américaines contre des cibles militaires et civiles, et l’usage illégal du napalm permit de détruire des champs de céréales et du bétail[77]. Sur leurs écrans de TV, les Américains assistèrent à un millier de sorties aériennes couvrant des villes entières de leurs bombes, littéralement hypnotisés par la vision de missiles détruisant des hôpitaux, des réservoirs d’eau potable ou des écoles[78]. Des soldats dirent que c’était comme « tirer des poissons dans une bassine[79] ». Malgré les efforts pour transformer la réalité des massacres en rebaptisant les bombardements « tirs chirurgicaux » et les dizaines de milliers de victimes civiles « dommages collatéraux », le Pentagone dut admettre qu’il avait massivement visé les structures civiles pour « démoraliser la population[80] ». En particulier, des attaques furent dirigées contre des usines d’épuration, des systèmes d’irrigation et des installations de purification d’eau, provoquant la mort massive d’enfants de diarrhée, de typhoïde et d’autres maladies infectieuses[81]. Mais dans l’esprit des Américains, la schizophrénie était presque totale : on tuait des êtres humains, mais ils n’étaient que virtuels. Un journaliste de TV affirma, après que 8’000 sorties de bombardiers aient pulvérisé les objectifs civils irakiens : « Bientôt, nous devrons stopper la guerre aérienne et commencer à tuer des êtres humains[82]. » Rivés à nos écrans TV, possédés par la transe de guerre, nous avons apprécié l’évènement parce qu’il avait « un sinistre aspect de guerre télécommandée... comme si nous étions en face d’une guerre technologique virtuelle[83] » ou une scène de Star War avec Luke Skywalker faisant exploser les forteresses de Darth Vader avec des bombes laser de haute technologie qui ne détruisent que les machines, pas les gens.
Le carnage humain revivifia la nation américaine. Comme Bush avait rempli la tâche principale qui lui était assignée – purifier le groupe de ses sentiments de culpabilité par un sacrifice – sa popularité explosa. Oliphant dessina une caricature du sac à main de Bush remisé dans une armoire en l’honneur de son rôle de puissant chef de guerre. Les caricaturistes redevinrent joyeux, montrant des Américains qui se tenaient par la main et dansaient tandis que les bombes tombaient sur l’ennemi. Le fait de rejouer nos traumatismes d’enfance sur d’autres victimes que nous-mêmes était, une nouvelle fois, très excitant.
Mais la guerre fut aussi terrifiante que promise. En 43 jours, et dans les années d’embargo qui suivirent, l’Amérique accomplit ce que les Nations-Unies appelèrent « la destruction quasi apocalyptique » de l’Irak. Les bombardements équivalurent à sept bombes de Hiroshima. Plus d’un demi-million d’enfants furent tués[84] – la plupart des suites de malnutrition et d’épidémies causées par la destruction systématique de canaux d’irrigation, d’industries alimentaires, et par un embargo qui constitue une violation génocidaire des Conventions de Genève qui interdisent d’affamer des civils[85].
Après avoir dépensé cent milliards de dollars pour tuer des Irakiens, nous n’avions même pas tué le « démon » Saddam, mais seulement réinstallé au Koweit une monarchie féodale. En fait, Bush choisit de ne pas poursuivre Saddam, de ne prendre aucune initiative qui puisse conduire à sa destitution, sentant que les États-Unis pourraient un jour encore avoir besoin d’un ennemi sur lequel compter. Nous avions essentiellement tué des femmes et des enfants innocents, représentant les Mères furieuses et les Enfants désobéissants présents dans notre propre inconscient. Nous avions réalisé une fusion inconsciente avec les bourreaux de notre enfance, purifié la violence réprimée dans nos esprits et, du fait de notre épouvantable sacrifice d’humains innocents, nous sentions nettement mieux en tant que nation[86].
Dans ce contexte de sacrifice, l’empathie pour les innocents était totalement absente. Le public américain ne remarqua même pas qu’un génocide était en train de se passer. Dix ans plus tard, l’eau était polluée, les poubelles devaient être déversées dans les rues et les hôpitaux étaient pratiquement hors d’usage. Les enfants qui survécurent à nos intentions génocidaires furent décrits par l’organisation War Watch comme étant « les enfants les plus traumatisés par une guerre que l’on ait jamais rencontrés[87] ». La guerre avait permis de réaliser l’objectif inconscient d’un sacrifice. L’Amérique organisa une parade de la victoire. Le président dit aux Américains que « la face la plus sombre de la nature humaine » avait été défaite – plus précisément, la face la plus sombre de notre propre psyché avait été remise en actes – et nous assurait que la nation était entrée dans le Nouvel Ordre Mondial.
Le sacrifice rituel a été conduit exactement comme prévu : par un génocide de femmes et d’enfants. La nation américaine s’est purifiée de sa pollution émotionnelle et la popularité de Bush grimpa à 91 %, le score le plus élevé jamais atteint par un président en exercice. La bourse grimpa. « Bush... a rendu à l’Amérique son esprit d’entreprise... Ça fait du bien de gagner[88]. » Le pays était uni par ce massacre comme jamais il n’avait pu l’être par une réalisation positive. Notre leader remplit la mission que nous lui avions déléguée ; lorsque tout fut terminé, le président Bush dit à un présentateur de TV : « Nous avons réussi notre agression[89]. » Lorsqu’un journaliste demanda à Madeleine Albright, qui devint plus tard le secrétaire d’État du président Bill Clinton lors de son second mandat, si la mort de tous ces enfants du fait des sanctions économiques destinées à affaiblir Saddam Hussein étaient nécessaires, elle répliqua : « Je pense que c’est un choix très difficile, mais le prix, nous pensons, en vaut la peine[90]. » Les éditorialistes du pays félicitèrent le président pour avoir « vaincu le Mal » et spéculèrent sur ce que serait le Nouvel Ordre Mondial et quand il commencerait. Le vainqueur ne se sentait plus déprimé. La vingt-huitième guerre de l’Amérique était semble-t-il parvenue à restaurer notre puissance. Nous nous sentions lavés, purifiés, comme si nous avions vécu une renaissance.
Lloyd deMause*
© L. deMause – 11.2002 / regardconscient.net
Traduction française M.A. Cotton
*Lloyd deMause, psychohistorien de renom, est l’ancien directeur de l’Institute For Psychohistory de New York. Cet article, inédit en français, est le second chapitre de son livre livre The Emotional Life of Nations, Karnac Books, 2002, 450 pages.
L’Amérique, un rejouement planétaire
Les Puritains américains imposent au monde les conséquences de leur histoire non-résolue. La tragédie irakienne est une terrible remise en scène justifiée par l’aveuglement de ses protagonistes.
(04/2003)
Notes :
[1] L’étude la plus probant est de Glenn David, Childhood and History in America, Psychohistory Press, 1976. Pour des études psychobiographiques, voir aussi Henry Lawton, The Psychohistorian’s Handbook, Psychohistory Press, 1988, pp. 161-176.
[2] Voir Paul H. Elovitz, “Three Days in Plains”, et David Beisel, “Toward a Psychohistory of Jimmy Carter”, in Lloyd deMause et Henry Ebel, Eds., Jimmy Carter and American Fantasy: Psychohistorical Explorations, Two Continents, 1977, pp. 33-96.
[3] Ronald Reagan, Where’s the Rest of Me?, Karz Publishers, 1981, pp. 9 and 11.
[4] Voir la psychobiographie de Reagan in Lloyd deMause, Reagan’s America, New York: Creative Roots, 1984, pp. 36-50.
[5] Suzy T. Kane, “What the Gulf War Reveals About George Bush’s Childhood”, The Journal of Psychohistory, 20(1992): 149-166.
[6] Barbara T. Toessner, “Obedience, Diligence, and Fun: Bush’s Extraordinary Family Life”, Times Union, Jacksonville, Florida, January 15, 1989, p. A3. Voir aussi J. Hyams, Flight of the Avenger: George Bush at War, Harcourt Brace Jovanovich, 1991.
[7] Gail Sheehy, Character: America’s Search for Leadership, New York: William Morrow & Co., 1988, p. 160.
[8] Voir Lloyd deMause, Foundations of Psychohistory, Creative Roots Pub, 1982, pp. 172-243.
[9] “Is Peace Really Breaking Out All Over?”, Newsweek, August 1, 1988.
[10] David R. Beisel, “Europe’s Feelings of Collapse 1990-1993”, The Journal of Psychohistory, 21(1993): 133.
[11] The New York Times, March 3, 1990, p. D1.
[12] The New York Times, January 2, 1990, p. D11; New York Post, April 26, 1990, p. 4; Washington Post, October 2, 1990, p. A19.
[13] Lloyd deMause, “It’s Time to Sacrifice...Our Children”, The Journal of Psychohistory, 18(1990): 135-144.
[14] Benjamin J. Stein, ”Our Man in Nirvana“, The New York Times, January 22, 1992, p. A21.
[15] Washington Post, October 5, 1992, p. A8.
[16] Le résultat de l’augmentation de 165 milliards de dollars d’impôts fut de diminuer les recettes fiscales et de faire grimper le déficit de 1991 au plus haut niveau de l’histoire américaine, 385 milliards de dollars au lieu des 63 milliards prévus par le budget, soit une erreur de 322 milliards. Lire Lewis H. Lapham, “Notebook: Washington Phrase Book”, Harper’s Magazine, October 1993, p. 9; voir également Dean Baker, “Depressing Our Way to Recovery”, The American Prospect, Winter 1994, pp. 108-114.
[17] Cette phrase est de la Federal Reserve Bank en 1929, citée dans William Greider, Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the Country, Simon and Schuster, 1987, p. 300. Le seul économiste qui ait reconnu l’effet dépressif du paquet budgétaire de 1991 fut Robert Eisner, The Mistunderstood Economy: What Counts and How to Count It, Harvard Business School Press, 1994, p. 83.
[18] Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams, The Standard Edition of The Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol. IV., p. 260.
[19] Lire Lloyd deMause, “Heads and Tails’: Money As a Poison Container”, The Journal of Psychohistory, 16(1988): 1-18.
[20] William Greider, “The Shadow Debate on the American Economy”, Rolling Stone, July 14-28, p. 85.
[21] Lire aussi “The Poison Builds Up: There’s a Virus in our Bloodstream”, in Lloyd deMause, Reagan’s America, pp. 114-135.
[22] Paul Blustein, “Squeeze Play: The Slump We Need Has Started”, Washington Post, February 7, 1988, p. C1; Maxwell Newton, “Fed Must Move to Stem Growth in U.S. Economy”, New York Post, January 26, 1988, p. 35; “The Inevitable Tax Hike”, U.S. News & World Report, July 11, 1988, p. 17; Greider, “The Shadow Debate”, Rolling Stone, p. 85.
[23] Paul Volcker, cité par Greider, Secrets of the Temple, p. 70.
[24] Washington Post, November 26, 1990, p. B1.
[25] Henry Allen, “America, the Bummed”, Newsday, December 4, 1990, p. 82.
[26]John Toland, The Rising Sun: The Decline and Fall of the Japanese Empire, 1936-1945, Random House, 1970, p. 112.
[27] See David Beisel, The Suicidal Embrace: Hitler, The Allies and The Origins of the Second World War, à paraître, un livre qui sera l’étude la plus documentée sur les fondements émotionnelles des nations qui vont en guerre.
[28] U.S. Army Chief of Staff Carl Vuono, cité par Rick Atkonson, Crusade: The Untold Story of the Persian Gulf War, Houghton Mifflin Co., 1993, p. 273.
[29] Lawrence E. Stagher, “The Rite of Child Sacrifice at Carthage”, in John Griffiths Pedley, Ed., New Light on Ancient Carthage : Papers of a Symposium, University of Michigan Press, 1980, pp. 4, 6.
[30] Christopher Jencks, “Is Violent Crime Increasing?”, The American Prospect, Winter, 1994, pp. 98-107; Richard Morin, “Crime Time: The Fear, The Facts”, Washington Post, January 30, 1994, p. C1.
[31] Miles Harvey, “Hollywood’s mega-monster horror hits and misses”, In These Times, March 20-26, 1991, pp. 22-25.
[32] Lloyd deMause, “It’s Time to Sacrifice...Our Children”, The Journal of Psychhistory, 18(1990): 142.
[33] Lloyd deMause, “The Gulf War as a Mental Disorder”, The Journal of Psychohistory, 19(1991): 1-22; voir également les autres articles de cette édition spéciale sur la guerre du Golfe (automne 1990).
[34] Murray Waas and Craig Unger, “In the Loop: Bush’s Secret Mission”, New Yorker, November 2, 1992, pp. 64-84; Kenneth Timmerman, The Death Lobby: How the West Armed Iraq, Houghton Mifflin, 1992; Alan Friedman, Spider’s Web: The Secret History of How the White House Illegally Armed Iraq, Bantam Books, 1993.
[35] “Iraqgate”, U.S. News & World Report, May 18, 1992, pp. 42-51; “Did Bush Create This Monster?”, Time, June 8, 1992, pp. 41-42; Stephen Pizzo, “Covert Plan”, Mother Jones, July/August, 1992, pp. 20-22.
[36] Alan Friedman, “The President Was Very, Very Mad”, The New York Times, November 7, 1993, p. E15; Friedman, Spider’s Web, op. cit.
[37] Ibid.
[38] Anna Aragno, “Master of His Universe”, The Journal of Psychohistory, 19(1991): 96-108; Peter Waldman, “A Tale Emerges of Saddam’s Origins That Even He May Not Have Known”, The Wall Street Journal, February 7, 1991, p. A10; Gail Sheehy, “How Saddam Survived”, Vanity Fair, August 1991, pp. 31-53; J. Miller and L. Mylroie, “Saddam Hussein and the Crisis in the Gulf”, Times Books, Random House, 1990.
[39] Ramsey Clark, The Fire This Time: U.S. War Crimes in the Gulf, Thunder’s Mouth Press, 1992, pp. 12-16.
[40] Ibid., p. 15.
[41] Ibid.
[42] Jonathan Vankin, Conspiracies, CoverUps, and Crimes: Political Manipulation and Mind Control in America, Paragon House Publishers, 1991, p. 203.
[43] Peter Mantius, “Iraqgate: Shell Game”, In These Times, January 22, 1996, p. 28.
[44] Ibid., p. 23; voir également la description de Clark sur la manière dont Glaspi mentit au Congrès sur ses propos à Hussein, p. 24.
[45] The New York Times, October 25, 1992, p. A1;
[46] Ibid.; The New York Times, September 23, 1990, pp. L18 and L19; The Washington Post, September 19, 1990, p. A19; Paul A. Gigot, “A Great American Screw-Up: The U.S. and Iraq, 1980-1990”, The National Interest, Winter 1990/91, pp. 3-10.
[47] Ramsey Clark, War Crimes: A Report on United States War Crimes Against Iraq, Maisonneuve Press, 1992, p. 67.
[48] Jean Edward Smith, George Bush’s War, Henry Holt and Co., 1992, p. 64.
[49]. Robert B. McFarland, “War Hysteria and Group-Fantasy in Colorado”, Journal of Psychohistory, 19(1991) : 36; Smith, George Bush’s War, pp. 7-8.
[50] Jean Edward Smith, George Bush’s War, Henry Holt and Co., 1992, p. 68.
[51] DeMause, “It’s Time to Sacrifice”, op. cit., p. 143.
[52]. The New Republic, September 3, 1990, p. 9.
[53] Ben Wattenberg, “Thanks Saddam, We Needed That”, New York Post, January 17, 1991, p. 8.
[54] Theodore Draper, “The True History of the Gulf War”, The New York Review of Books, January 30, 1992, p. 41.
[55] Ce coup monté est entièrement décrit par Clark, The Fire This Time, pp. 31-32 et dans John R. MacArthur, “Remember Nayirah, Witness for Kuwait”, The New York Times, January 6, 1991, A17.
[56] Ibid.
[57] DeMause, America’s Search for a Fighting Leader, pp. 122-123.
[58] DeMause, Gulf War, pp. 12-14; Lloyd deMause, Foundations of Psychohistory, op. cit., pp. 244-332.
[59] Burr C. Brundage, The Fifth Sun: Aztec Gods, Aztec World, Austin, University of Texas Press, 1979; Patricia R. Anawalt, “Understanding Aztec Human Sacrifice”. Archaeology, 35(1982): 38-45; Elizabeth P. Benson and Elizabeth H. Boone, Eds. Ritual Human Sacrifice in MesoAmerica, Dumbarton Oaks Research Library, 1985; Burr C. Brundage, “The Jade Steps: A Ritual Life of the Aztecs”, University of Utah Press, 1985.
[60] Des détails du combat rituel peuvent être trouvés dans Theodore H. Gaster, Thespis: Ritual, Myth and Drama in the Ancient Near East, Harper and Row, n.d.; Valerio Valeri, Kingship and Sacrifice: Ritual and Society and Ancient Hawaii, The University of Chicago Press, 1985; Brundage, The Jade Steps: A Ritual Life of the Aztecs”, op. cit.; deMause, “The Gulf War as a Mental Disorder”, op. cit., pp. 12-14.
[61] Pour les liens entre la guerre et les deux hémisphères cérébraux, lire mon chapitre 6: “War as Righteous Rape of Purification”, in The Emotional Life of Nations, Karnac Books, 2002.
[62] Valeri, Kingship and Sacrifice, op. cit., p. 165.
[63] DeMause, Foundations of Psychohistory, op. cit., pp. 1-83.
[64] New York Post, June 11, 1991, p. 16; WABC-TV, February 28, 1991; Washington Post, February 24, 1991, p. A26.
[65] Rafael Patai, The Arab Mind, Charles Scribners Sons, 1983; The Wall Street Journal, February 7, 1991, p. A1; The New York Times, January 7, 1991, p. A1.
[66] The New York Times, October 11, 1994, p. A13.
[67] New York Post, August 11, 1990, p. 3; New York Newsday, January 12, 1991, p. 10.
[68] New York Post, January 17, 1991, p. 31.
[69] Ramsey Clark, The Children Are Dying, Maisonneuve Press, 1996, p. 113.
[70] The New York Times, January 16, 1991, p. A1 and January 18, 1991, p. A1.
[71] David Roth, Sacred Honor: The Biography of Colin Powell, Zondervan Books, 1993; Howard Means, Colin Powell: A Biography, Ballantine Books, 1992.
[72] Jean Edward Smith, George Bush’s War, op. cit., p. 8; Rick Atkinson, Crusade: The Untold Story of the Persian Gulf War, Houghton Mifflin Co., 1993, p. 347-348.
[73] George H. Bush, A World Transformed, Knopf, 1998, p. 201.
[74] Bob Woodward, Shadow: Five Presidents and the Legacy of Watergate, Simon and Schuster, 1999, p. 185.
[75] Ibid., p. 187.
[76] Ramsey Clark, War Crimes: A Report on United States War Crimes Against Iraq, Maisonneuve Press, 1992, p. 15.
[77] Ibid., p. 17.
[78] Les bombes américaines ont frappé 28 hôpitaux civils, 52 centres collectifs de santé, 676 écoles, et 56 mosquées. Lire Clark, The Fire This Time, pp. 66. Sur le rôle de la TV américaine d’un point de vue psychohistorique, lire Daniel Dervin, From Oily War to Holy War: Vicissitudes of Group-Fantasy Surrounding the Persian Gulf Crisis, The Journal of Psychohistory 19(1991): 67-83.
[79] Elizabeth Drew, “Letter from Washington”, New Yorker, May 6, 1991, p. 101.
[80] Ibid., p. 69.
[81] David Barsamian, “Iraq: The Impact of Sanctions and U.S. Policy”, Z Magazine, July/August 1999, pp. 44-45.
[82] WCBS-TV, January 21, 1991.
[83] The Nation, December 14, 1998, p. 5.
[84] Ramsey Clark, The Children Are Dying, Maisonneuve Press, 1996.
[85] “Out Now, Weapons of Mass Destruction”, War Watch, November-December 1991, pp. 1-10; Kane, “What the Gulf War Reveals About George Bush’s Childhood”, op. cit., pp. 149-150; Robert Reno, Heck, “Let’s Drop a Few More if The Allies Are Buying”, New York Newsday, May 16, 1991, p. 50; William M. Arkin, “The Gulf ’Hyperwar’–An Interim Tally”, The New York Times, June 22, 1991, p. 23; Nina Burleigh, “Watching Children Starve to Death”, Time, June 10, 1991, p. 56; Ross B. Mirkarimi, “Disease, despair, destruction still plague Iraq”, In These Times, June 10-23, 1992, p. 10; Clark, The Fire This Time, op. cit., p. 43; Draper, The True History of the Gulf War, op. cit., pp. 36-45.
[86] Le gouvernement américain a utilisé l’arme illégale de l’embargo contre les populations civiles à Cuba, Panama, en Libye, en Iran, au Vietnam, au Nicaragua et en Corée aussi bien qu’en Iraq.
[87] Julia Devin, directrice exécutive de l’International Commission on Medical Neutrality, November 13, 1991, citée par Draper, True History of the Gulf War, op. cit., p. 40.
[88] Ann McFeatters, “The Good Guys Won, and America’s Can-do Spirit Was Restored”, Chicago Tribune, March 1, 1991.
[89] Noam Chomsky, Chomsky on MisEducation, Rowan and Littelfield Publishers, 2000, p. 33.
[90] “60 Minutes”, WCBS-TV, May 23, 1996.

