
Aux sources de la violence contemporaine 1/3
Le discours éducatif dominant favorise le mépris des enfants
Résumé : Une certaine dialectique sur l’éducation justifie la violence exercée sur l’enfant et transforme ce dernier en une « créature insuffisante et misérable ».

Au début de l’année, le Temps stratégique publiait un numéro ayant pour titre « Faut-il traumatiser pour éduquer ? » Plusieurs personnalités, dont le pédagogue Philippe Mérieu et l’écrivain Jean Romain, tombaient d’accord pour dire qu’il est nécessaire d’appliquer à l’enfant une certaine violence dans le processus éducatif. Un discours tendancieux, mais mobilisateur, à l’heure où la violence manifestée par certains jeunes inquiète et que la loi de la jungle règne au plan mondial. En préambule à ce dossier, l’éditorialiste Claude Monnier écrivait :
« Le premier devoir de celui qui se veut éducateur est donc de ne point se voiler la face devant le fait qu’il a mission de faire violence à l’enfant. S’il se convainc de ce point, son devoir sera alors de travailler cette violence pour la rendre bonne. En effet, la violence – qui n’est rien d’autre, étymologiquement, qu’une “force appliquée” à quelqu’un ou à quelque chose – peut fonder les plus belles réussites de pédagogues de génie comme les crimes les plus ignominieux de tortionnaires nazis[1]. »
Cette pensée repose sur trois axes :
- L’éducateur a des devoirs, s’il veut se prévaloir de son rôle.
- Sa mission est de faire violence à l’enfant.
- La violence n’est, en elle-même, ni bonne ni mauvaise.
En d’autres termes, le pédagogue lucide – parent ou enseignant – devrait se contenter d’appliquer à l’enfant une méthode aux conséquences hasardeuses, en faisant fi de sentiments humains. Car si la violence n’était rien d’autre qu’une force appliquée, comment pourrait-elle par ailleurs fonder les crimes les plus ignominieux ?
Cette rhétorique a le mérite de mettre en évidence deux choses importantes. D’une part, l’acte qualifié d’éducatif est clairement associé à l’exercice d’une violence. D’autre part, dans l’exercice de cette violence, l’éducateur est confronté à un sentiment de culpabilité. Avant de triompher de l’enfant, il devra d’abord livrer un combat contre lui-même, infligeant à sa propre sensibilité le traitement qu’il appliquera ensuite au plus jeune. Pour le convaincre du bien-fondé de sa dureté, l’idéologie éducative va lui promettre les meilleures louanges, mais lui imposera également en retour la pleine responsabilité de ses actes. Une initiation par la carotte et le bâton, en quelque sorte :
« Si l’éducateur est bon, humain, intelligent, équilibré, talentueux, aguerri, et que sa loi morale intérieure est ferme, il appliquera la dureté aux enfants dont il a la charge avec un extrême talent et une extrême finesse, comme les grands peintres ajoutent de minuscules touches de couleurs violentes à leurs compositions les plus douces. Si, en revanche, l’éducateur ne réunit pas en lui ces qualités rares, le risque est réel qu’il se transforme en bourreau ou en lavette[2]. »
Ce discours fait l’impasse sur les origines de la violence éducative et en banalise les conséquences. Par une métaphore poétique, il masque l’inflexibilité du projet de l’adulte sur l’enfant. Ce dernier n’est plus un frère humain, un semblable, mais un objet animé sur lequel l’éducateur doit appliquer la dureté avec une précaution chirurgicale. Pour que l’action éducative puisse continuer de s’exercer sans état d’âme, il faut que cet enfant incarne des valeurs détestables et qu’au contraire l’adulte soit présenté sous un noble jour :
« C’est à travers l’œuvre et grâce à la maîtrise d’un adulte que l’élève parviendra à s’augmenter, à quitter son ignorance, à se méfier de ses instincts étroits ou de ses passions. Bref à se libérer, car cet apprentissage à deux, par le mûrissement personnel et par la responsabilité individuelle, est un apprentissage raisonné de la liberté. L’élève, en faisant confiance à son maître, apprend l’autonomie, s’initie à son métier d’homme – social et cultivé[3]. »
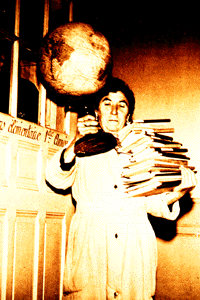
Les exigences des adultes pèsent lourdement sur la vie de l’enfant qui, devenu grand, reproduira cette pression sur sa progéniture.
À l’image du « nègre » de l’Occident colonial, l’enfant devient une créature insuffisante et misérable. Son salut ne réside que dans sa soumission docile à l’influence civilisatrice de l’adulte instruit. Comme pour l’esclave affranchi, sa liberté est accordée sous conditions par le consentement paternaliste du maître. En termes à peine voilés, ce dernier exige la déférence de celui dont il ne peut reconnaître les richesses et qu’il considère, au fond, comme un être méprisable.
Comment l’adulte – qui fut lui-même enfant – peut-il manifester un tel mépris pour sa propre mémoire ? Dès 1923, Freud a formulé le terme de déni pour caractériser le refoulement inconscient de souvenirs douloureux. Plutôt que de se confronter à la brutalité de ses propres éducateurs, l’enfant devenu adulte préfère nier en lui les séquelles de leurs mauvais traitements. Prenant le relais, le lyrisme du discours éducatif favorise ce refoulement et justifie la reproduction de la violence exercée sur l’enfant :
« Mûrir, c’est mourir un peu. Faire d’une certaine façon le deuil du lieu d’où l’on vient pour permettre au lieu où l’on va de jouer un rôle plus important. Mûrir, c’est quitter l’enfance pour s’élever peu à peu vers la maturité, admettre que les valeurs propres à l’enfance devront être par degrés remplacées par les valeurs de responsabilité et d’autonomie de l’adulte[4]. »
Du point de vue de l’être, faire le deuil de son enfance, ce n’est pas s’élever vers la maturité mais se résigner à chasser dans l’oubli les souffrances issues du déni de cette enfance, dans l’espoir d’être accepté par les « grands ». C’est se condamner à l’exil intérieur.
S’il en avait les mots, voici ce que l’enfant dirait peut-être du vécu de son éducation vers le monde des adultes :
« Vous, mes Parents et mes Maîtres, me dites que je dois mûrir, c’est-à-dire quitter l’univers qui m’anime pour m’élever vers vous alors que vous-mêmes, bannis de votre propre enfance, ne pouvez me rejoindre là où je suis. Vous me demandez de remplacer mon énergie de vie par vos projections, érigées en valeurs. Vous me demandez – responsabilité et autonomie – de ne compter que sur mes propres forces, celles qui me servent aujourd’hui à contenir la souffrance de vivre dans un monde sans amour. »
En voulant endurcir nos enfants dans l’espoir qu’ils s’adaptent à la folie du monde, nous nous rendons complices d’un double crime. D’une part, nous accélérons la dégradation d’une société désorientée par la perte de ses repères. D’autre part, en niant les conséquences de notre propre violence, nous faisons le lit des violences futures. Si les grandes personnes reprochent facilement aux enfants leur infantilisme, ces derniers pourraient aussi nous demander les comptes de notre adultisme.
Marc-André Cotton
© M.A. Cotton – 10.1998 / regardconscient.net
Violences contemporaines (2) : consommer pour ne pas ressentir le manque d’amour
Les mécanismes d’asservissement à la consommation sont intimement liés aux manques relationnels imposés à l’enfant dès son plus jeune âge.
(10/1998)

