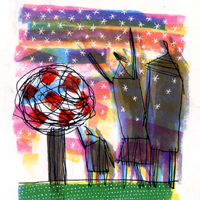Mainmise
De la protection à la possession
Résumé : Aujourd’hui, l’imposant édifice médical n’a d’autre objectif que de se maintenir à n’importe quel prix, afin de retarder la mise à jour de ses responsabilités. C’est pourquoi il résiste à la résolution de son histoire.

Un des premiers sens de soigner en ancien français était « procurer, fournir quelque chose à quelqu’un » et témoignait que les préoccupations des hommes tournaient autour des marchés et des marchandises[1]. Il s’agissait avant tout de se nourrir et de nourrir les siens. Le sens évolua en « veiller à ce que », « conseiller, avertir », puis « s’occuper de, tenir propre ». Jusqu’au XVIIIe siècle, les hommes ne faisaient pas grande différence entre soigner les bêtes et prendre soin d’un enfant. Ils menaient des guerres interminables aux conséquences dévastatrices sur les femmes, sur les enfants et sur eux-mêmes. Dans le même temps, ils expérimentaient toutes sortes de pratiques et de techniques en manipulant leurs souffrances et celles de leurs semblables. Tel fut le terrain propice au développement d’un pouvoir médical structuré sur l’insensibilité et le déni. Parallèlement, les femmes étaient celles qui, quotidiennement, prenaient soin, écoutaient, pansaient et s’efforçaient de préserver la vie.
Soignante et concubine
Nous trouvons un lien étroit entre les soins qui guérissent et la présence féminine dans le mot soignante employé pour concubine. Dans les milieux dominants - nobles, bourgeois, artisans enrichis et arrivistes de toutes sortes - le mari ne dormait pas avec son épouse. Celle-ci, devenue mère, ne dormait pas avec ses enfants, les allaitait rarement, ne prenait pas soin d’eux. Cette « charge » était dévolue aux nourrices. L’homme choisissait donc une fille, une servante (parfois un garçonnet, un page) pour prendre soin de lui et compenser son impuissance à être en relation avec sa compagne légitime. En effet, il lui assignait pour rôle de valoriser, par ses comportements, ses ambitions sociales idéalisées. La concubine était une femme de condition inférieure. L’homme reconnaissait donc implicitement à cette présence des vertus qu’il déniait à son épouse qui était, elle, de condition égale ou supérieure et mère de ses enfants.
Cet éclatement des liens humains naturels, imposé par la domination masculine, et leur remplacement par des rôles, interdisaient toute relation simple et aimante, et verrouillait la soumission des membres de la maisonnée sous la terreur. Des domestiques s’affairaient désormais aux soins de chacun et compensaient spécifiquement l’énorme dépression relationnelle refoulée. Maîtresses et concubines servaient, réchauffaient, prenaient soin de l’homme dit adulte comme les nourrices l’avaient fait de l’enfant.
Médecine domestique
La volonté de pouvoir des classes dominantes ne pouvait advenir sans humilier et mépriser ceux sur lesquels elles régnaient, il fut donc rapidement inacceptable que des valets et des servantes soient dépositaires d’un pouvoir de compenser ou non la souffrance des maîtres. Protégés et encouragés par ceux-ci, certains hommes accumulèrent des connaissances et valorisèrent des pratiques qui assuraient une intensification du refoulement et une meilleure place dans la hiérarchie. De cette domesticité particulière, émergea peu à peu une nouvelle classe, soumise mais valorisée : les médecins du pouvoir.
Les moines, interdits d’étudier et de pratiquer la thérapeutique puis la chirurgie, laissèrent leurs connaissances aux clercs laïques. Certains médecins furent si méritants aux yeux des puissants qu’ils leur accordèrent le titre universitaire de Docteur qui, jusqu’alors, désignait les théologiens formés par l’Université. Les cercles du pouvoir et ses compensations leur étaient désormais grands ouverts.
Humiliation refoulée
Ce que les « doctes » médecins prirent pour une reconnaissance de leur capacité et de leur humanité était en fait une humiliation. Le sens de docteur, du verbe latin passif docere « enseigner, faire apprendre », exprime les notions de « régler, ordonner, juger la conformité à ce qui convient ». Le titre honorifique sanctionnait donc celui qui s’était soumis à la règle, devenait dépositaire de la doctrine et jugeait désormais de la soumission des aspirants docteurs. Les honneurs et les compensations récompensaient donc les médecins qui avaient refoulé en eux tout ce qui remettait en cause leurs maîtres et le pouvoir, c’est-à-dire leur conscience et leur sensibilité. La qualité de soigner était niée aux femmes et aux mères qui l’offraient, peu ou prou, à chaque instant comme une simple réalité humaine, et octroyée à ceux-là mêmes qui menaçaient la vie par leur déni et leur docilité aux rejouements dominants. Il n’est dès lors pas étonnant que la médecine s’enfonce depuis dans la technique et la recherche.
Bernard Giossi
© B. Giossi – 12.2003 / regardconscient.net
Serment d’allégeance
Il existe plusieurs versions du fameux Serment d’Hippocrate que prêtent les étudiants en médecine lors de la soutenance de leur thèse. Toutes ont en commun de définir l’allégeance qui lie l’aspirant médecin à ses « Maîtres de médecine », figures idéalisées du père auquel ils soumettent leur conscience et leur responsabilité.
La formule suivante atteste par exemple de cette fidélité névrotique : « Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours[2]. » D’autres formules scellent la loi du silence qui règne sur la profession et interdisent toute remise en cause : « Je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué » ou encore « Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. » Le médecin s’interdit également de faire aucun lien entre la maladie et le vécu relationnel des personnes qu’il soigne : « Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe. »
Finalement, son obéissance devrait lui garantir « honneur et probité » aux yeux de ses pairs. Par contre, une remise en cause de l’ordre établi par ses maîtres lui vaudrait d’être « couvert d’opprobe et méprisé. » Le Serment d’Hippocrate ne laisse aucune place à la recherche de la vérité.
M.Co.
Le corps et la morale
L’apparition de maladies graves est plus fréquente chez les personnes ayant été maltraitées pendant leur enfance. Pour retrouver l’intégrité de sa santé, l’adulte doit se libérer de l’attachement qu’il éprouve à l’égard de ses parents abusifs.
(01/2004)
Notes :
[1] Les définitions sont extraites du Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, Paris, 1998.
[2] Lire par exemple Valentin Dancourt, « Le Serment d’Hippocrate », in Une histoire de la médecine, Homéopathe international, 2001.