
Manuscrit
Le Génie de l’être et l’interdit de voir
Essai pour un bond qualitatif de l’humanité
par Sylvie Vermeulen
Ce texte est désormais disponible dans l’ouvrage Le Génie de l’être et autres écrits, Le Hêtre Myriadis, 2021.
Résumé : La première partie de cet essai cherche à mettre en évidence la profondeur de la souffrance des êtres, enfermés dans la croyance du Mal en l’Homme. De par l’aveuglement de leur conscience, parents et éducateurs se persuadent de la présence de ce mal dans l’enfant. Les doctrines dites scientifiques qui découlent de ce regard biaisé favorisent la mise en scène d’anciens traumatismes refoulés dans l’inconscient et justifient les passages à l’acte sur l’enfant. Mais ce mécanisme de rejouement prend son sens lorsqu’il conduit à l’émergence d’une conscience libératrice. Sur ce chemin, la sensibilité de l’enfant est notre meilleur guide.
Introduction : La croyance du Mal en l’Homme
Chapitre 1 : Psychologie de la petite enfance – L’enfant, incarnation du Mal
- Croyance et aveuglement
- Le bébé, objet d’observation
- Le déni d’humanité
- Les exutoires du passé refoulé
- L’incarnation du Mal dans l’esprit scientifique
- Interprétation et comportement enfantin
- La sensibilité de nos enfants
- Le rejouement dans l’Histoire
- L’enfant, une invitation constante à la libération
- Auto-réducation collective
- L’idéalisation posée sur notre organisation collective
- Projections collectives et passages à l’acte
- L’Histoire, notre histoire
- Une terrible tragédie
- La métamorphose
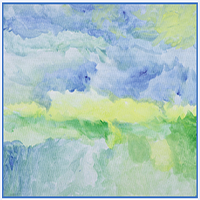
La misère sous toutes ses formes
est le cri constant
de la conscience humaine humiliée.
Elle envahit le monde,
de sa profondeur en chacun.
Les êtres qui naissent
sont contraints au terrible apprentissage
du refoulement de leur conscience.
L’aveuglement qui en résulte rend impossible
la jouissance de notre véritable nature.
Introduction : La croyance du Mal en l’Homme
Ce que l’on attribue communément à l’Homme
est certainement ce qui le définit le moins.
Sans en être réellement conscient, chacun vit et se comporte en fonction d’affirmations erronées. À force de les entendre, ces dernières finissent par devenir des croyances profondément enracinées dans la psychologie humaine. La croyance du mal en l’Homme est de loin la plus dévastatrice.
Les guerres, les génocides, les colonisations et les répressions sont dominés par cette terrible interprétation de la sensibilité humaine. Notre Histoire nous montre que cette pensée, posée comme un principe de réalité, est constamment nourrie par les divers pouvoirs en place. Lorsque celle-ci n’est pas ouvertement affirmée comme chez Malebranche (1638-1715) qui écrivait : « C’est que nous naissons pécheurs et corrompus, dignes de la colère divine, et tout à fait indignes de penser à Dieu, de l’aimer, de l’adorer, de jouir de lui[1], » elle est incessamment présente comme dans la pensée de Pascal (1623-1662) : « L’homme est grand en ce qu’il se connaît misérable. »
Plus proche de nous, la prétendue malveillance de nos semblables occupe tous les journaux depuis plus de deux siècles. Des mouvements comme la psychanalyse leur ont emboîté le pas. Cette dernière affirme encore aujourd’hui, par la bouche de ses vulgarisateurs, qu’« il existe au fond de chacun quelque chose qui veut la destruction de l’autre[2]. »
Je me suis heurtée à cette croyance tout d’abord dans ma famille, puis à l’école, au catéchisme, dans le monde du travail et lors de mes recherches en psychologie. Étudiant nombre d’investigations faites dans le domaine des sciences humaines, je retrouvai toujours l’adhésion à cette pensée.
Dans mon enfance
L’affirmation changeait de teneur selon les lieux. Les membres de ma famille n’étaient pas vraiment convaincus. Même si cette idée justifiait fortement leur éducation, ils me laissaient un espace pour réaliser autre chose. Le curé, lui, était catégorique et même l’instituteur. Le professeur nuançait ses propos, mais l’employeur n’en démordait pas. Il suffisait de regarder son comportement vis-à-vis du personnel. À la télé, c’était preuve après preuve. Nous passions de la bêtise humaine à son oisiveté pour aboutir immanquablement à sa monstruosité sous toutes ses formes.
L’affirmation changeait aussi de teneur selon les âges. Elle était inexistante chez les enfants ; les adolescents s’en défendaient ; les jeunes gens étaient bien trop occupés pour réfléchir à la véracité d’une telle pensée. C’était la nouvelle génération de parents qui reprenait le flambeau du discours dévastateur. Les grands parents confirmaient, torturés qu’ils étaient par une religieuse culpabilité. Ils craignaient le mal comme l’enfer.
Considérant ce qui précède, je réalisai que toutes les structures autoritaires justifient leur domination par cette croyance. Je regardai alors se déployer dans l’Histoire de nos Républiques, les institutions dont les fondations reposent essentiellement sur cette simple torsion de la vérité. Je me représentai avec horreur toutes les injustices faites en son nom.
Malgré les innombrables injonctions subies par les enfants, le résultat escompté n’a jamais été ni atteint, ni acquis. La croyance du mal en l’Homme n’a pas pénétré l’âme enfantine. Même des siècles de conditionnement n’ont pas pu violer cette conscience humaine de l’enfant qui naît. L’enfant incarne des lois naturelles différentes de celles qui maintiennent tout Pouvoir en place. Il est vrai, spontané, heureux et curieux de tout. Il est intensément présent et respectueux.
La religion
L’enjeu du pouvoir justifie tous les moyens pour le conserver. C’est pour cette raison que ses représentants – inconscients d’eux-mêmes et de leurs rejouements – ont hiérarchisé puis administré leur domination.
Dans L’Église et la République, Anatole France nous présente ainsi l’Église romaine de la fin du XVIIIème siècle : « [Elle possédait] d’immenses richesses, de vastes territoires, des fondations en grands nombres. Elle dominait dans les plus importantes administrations de l’État : aux Cultes, comme religion de la majorité des français; à l’Instruction publique, où elle avait conquis sur l’Université affaiblie les trois degrés de l’enseignement; dans les établissements hospitaliers, desservis par ses religieuses; à l’armée, qu’elle fournissait d’officiers formés dans ses écoles[3]. »
Pour maintenir un tel pouvoir, les moyens utilisés étaient immanquablement ceux que les religieux avaient subis enfants : terreur puis soumission aux valeurs et aux croyances parentales et sociales, impliquant une constante répression de son propre senti, de sa propre vérité. Monseigneur l’évêque de Sees, dans une lettre pastorale du mois d’août 1904, a excellemment défini une condition si haute et si singulière : « L’Église a des droits imprescriptibles sur l’homme aussi bien que sur la société. Elle les tient de Dieu et personne ne peut les lui enlever... Elle est l’autorité de Dieu sur la terre et cette autorité doit s’exercer sur les âmes qui relèvent de son domaine, sur les corps dans toutes les questions qui se rapportent à la conscience, sur toutes les questions sociales qui touchent au domaine de l’esprit[4]. »
L’Église a structuré une gigantesque administration pour convaincre l’adulte, puis l’enfant innocent, de son état de péché. Les Républiques fondèrent leurs institutions sur les mêmes bases. Elles se contentèrent de desserrer le nœud d’une impressionnante prise de pouvoir sur les êtres humains. Sur cette condamnation toujours présente de l’Homme, elles sacralisèrent leurs institutions pour imposer à tous la primauté d’une citoyenneté assujettie au pouvoir. Cette dernière n’étant pas naturelle, elle implique une mise en condition toute particulière assurée aujourd’hui par l’école.
L’école de la République
Napoléon, déjà, rappelait expressément que le but de l’Université est de « former pour l’État des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille[5]. » En 1883, dans sa charte de la laïcité, Jules Ferry place au premier rang l’enseignement moral et civique. Il affirme une volonté de former une éducation nationale fondée sur les notions de devoirs et de droits.
Les Français restèrent sous l’emprise de la vieille croyance. Perdurèrent donc le déni ou la répression de la sensibilité et de la conscience humaine. Ceci contribua à installer au sein des écoles un enseignement patriotique favorable au renforcement de l’unité nationale et un enseignement moralisateur investissant toutes les matières enseignées d’une morale imposant le respect de l’ordre établi. « Pour les théoriciens de la laïcité, [...] le respect de la loi morale, cette victoire sur soi-même, est le fondement de la vraie liberté[6]... » La nécessité d’une victoire sur soi-même dans les écoles républicaines, montre à quel point demeurait la croyance du mal en l’Homme. Aujourd’hui encore, l’Éducation nationale développe une pédagogie de la maîtrise de soi qui tend à corriger les "travers" de nos enfants.
Dans cet essai, j’interpelle votre sensibilité là où nous nous détournons de nous-mêmes, là où notre société et notre éducation, fruits de nos rejouements collectifs, poussent notre aveuglement à ses extrêmes ; là où le déni de l’extraordinaire Amour de l’Homme est interprété par son contraire tant son immense souffrance, présente et passée, est refoulée, niée, interprétée et manipulée.
¨
Chapitre 1 : Psychologie de la petite enfance – L’enfant, incarnation du Mal
Lorsque les adultes ne comprennent pas le comportement des jeunes, les vieilles croyances ressurgissent. Sous couvert d’information, de vulgarisation, de mise à disposition d’éléments de compréhension sur l’enfance et la jeunesse, les parents et les éducateurs se voient invités à suivre une pensée prônant encore les mêmes rapports, à savoir, pour les parents : être capables de se faire respecter, et pour les enfants : apprendre à obéir et à se maîtriser. Les discours se gonflent d’avertissements. Les dérapages sont toujours pointés comme étant les fruits du laxisme, de l’indifférence, du désengagement parental, bref, d’un manque d’éducation. Autorité, discipline et exigences sont présentées, depuis des siècles, comme les garantes d’une bonne éducation. Mais l’Histoire nous montre que cette éducation n’a jamais abouti à la réalisation escomptée, c’est à dire à la joie de vivre en harmonie les uns avec les autres dans le respect d’une loi naturellement juste et reconnue par tous.
Croyance et aveuglement
L’éducateur veut extirper le mal, l’enrayer mais à défaut, il s’acharne à vouloir en discipliner les manifestations. Il ne voit pas suffisamment que « le mal » est la manifestation de la souffrance refoulée. Il ne voit pas qu’il est l’appel constant d’une Vie dont on bafoue les lois immuables. La souffrance est tellement profonde qu’elle semble ne plus avoir d’origine ni même d’existence. Nos croyances vont jusqu’à lui offrir une normalité.
Nous retrouvons, dans les courants de la psychologie de la petite enfance, ces croyances qui, de tout temps, édifièrent les sociétés humaines. L’enfant, dès les premiers âges, y est placé en tant que « metteur en scène de sa vie[7] », c’est-à-dire comme une personne responsable de ce qu’elle met en œuvre. En réalité, comme nous le développerons dans cet essai, ce que l’enfant assure c’est la représentation sur la scène de la vie d’une œuvre dramatique : celle de sa lignée familiale. Et la projection métaphorique qui consiste à dire que l’enfant est metteur en scène de sa vie révèle le caractère égotique et projectif de l’adulte.
J’entends par caractère égotique une véritable forteresse sensée protéger l’intégrité de l’être de tout éclatement. C’est, au début de sa formation, une structure de refoulement dynamique qui gère le refoulé et les inlassables tentatives de libération de l’être. Il est aussi une structure d’adaptation à un système despotique élaboré et imposé par les rejouements des adultes. Le caractère égotique est donc complètement induit chez le jeune enfant puis moulé et modulé par l’éducation de ses parents. Dès lors, nos prises de conscience sont les seules garantes d’une véritable libération de notre esprit et de notre corps. Elles impliquent l’inévitable introspection qui remet en cause toutes les croyances qui ont édifié notre déviance.
L’enfant n’est pas metteur en scène de sa vie. Il n’est pas naturellement doté d’une insensibilité égotique qui caractérise l’adulte identifié à sa structure. Ce qui se glisse dans cette affirmation, c’est la volonté qu’il le devienne. Ce genre de subterfuge est le propre de toute éducation. Les pédagogies qui en découlent ont été habilement maniées de telle sorte que ces lieux de torsion occasionnent des nœuds psychiques pratiquement indécelables et qui vont pourtant justifier le pouvoir sur soi et sur les autres. En tant qu’éducateur, nous sombrons alors dans le rejouement compulsif de ce que nous avons subi.
Ne pas remettre en cause la croyance du mal en l’Homme et l’accepter comme une réalité incontournable nous enferme dans la croyance de la présence de ce mal dans l’enfant. La psychologie qui en découle interprète et manipule le comportement de l’enfant, voire du bébé, en fonction de cet a priori.
Notre besoin de vivre conscient nous pousse inéluctablement à rejouer nos souffrances. Ainsi, dans le contexte particulier de la psychologie de la petite enfance, il nous pousse, entre autres, à formuler les principes éducatifs subis. Du principe éducatif à la « réalité objective » , il n’y a qu’une torsion de la vérité, et de cette « réalité objective » à la mise en application, une autre. C’est ainsi que dans le long déroulement des chaînes de torsions, nous passons de croyances à valeurs humaines applicables et nous justifions l’injustifiable.
De ce déroulement naissent bon nombre de théories comme celle qui institutionnalise la séparation de la mère et de l’enfant à des fins de socialisation précoce ou celle qui légitime l’expérimentation sur des animaux, voire des humains. Aussi éloignés qu’ils puissent paraître, ces deux exemples procèdent d’une même vision de la vie.
L’être humain est sensibilité, présence, conscience, vérité et amour. L’enfant naît avec toutes ces spécificités humaines. Mais pour lui, tout commence par un senti chargé de tout un passé, de toute une histoire, celle de sa lignée. Ses parents en sont les représentants et de leur aptitude à rester proches d’eux-mêmes – malgré leurs souffrances, les pressions éducationnelles et les exigences sociales – survivra ou non la joie d’être en relation.
Le bébé, objet d’observation
Il suffit que l’être qui naît ne mesure que 51 cm et ne pèse que 3 kilos et demi pour qu’il se voie retirer le statut d’être conscient, doté d’une sensibilité bien plus subtile qu’organique, rythmique, réflexive, pulsionnelle ou instinctive.
Comme objet d’observation, le bébé perd immédiatement sa raison d’être en ce monde. L’observateur l’isole de l’évolution harmonieuse de ce dernier et de l’Histoire des Hommes et le réduit à un fonctionnement organique. Ce genre d’observation se limite à des sélections et des projections qui mettent en scène le rejouement d’une situation bien précise, propre à l’observateur.
La relation du bébé au monde se réduit d’autant. On lui attribue par exemple la capacité de « se déployer en rythme en direction de toutes les stimulations qui l’atteignent avec assez d’intensité[8]. » Ce vocable scientifique nie la présence consciente de l’être observé. L’observateur ampute radicalement la dimension humaine de l’enfant et s’en attribue une qui lui viendrait entre autres de sa formation scientifique et de ses instructeurs. Cet homme, ne pouvant cependant manquer d’humanité, agit en fonction d’un besoin impératif de conscience. Pour que cette dernière advienne, il sélectionne dans le présent les données nécessaires à la mise en scène de l’aveuglement inconsidéré de ses propres parents. La souffrance occasionnée par le déni de cette conscience ne tolère aucune autre priorité que sa mise à jour, même pas celle du respect de l’intégrité ou de la vie d’un enfant.
Ces passages à l’acte, cautionnés par la science, engendrent des extrêmes. En 1981, naissait en Norvège un enfant appelé Per. Sa mère était une pédagogue s’occupant d’éduquer des enfants et son père, le Dr Arild Karlsen, était un psychologue spécialiste du comportement. Personne ne voyait jamais Per. Un jour la femme de ménage ouvrit la porte interdite. Elle vit un enfant de presque un an, enfermé dans une cage en verre munie d’appareillages compliqués destinés à renouveler l’air. L’enfant avait un regard absent et fixait le vide. Per avait neuf mois et avait vécu depuis sa naissance dans une espèce de cage d’apprentissage, une boîte en verre que le père appelait Skinner-Box !
D’un commun accord, les parents de Per avaient voulu étudier sur leur propre enfant les réactions d’un nouveau-né complètement séparé de sa mère et du monde extérieur. Ils l’avaient emprisonné comme un sujet d’expérience dans la cage qu’ils lui avaient aménagée avant sa naissance et d’où ils ne l’avaient jamais sorti. Per y gisait complètement nu et était alimenté artificiellement sans aucun contact avec ses parents.
Le Docteur Karlsen n’était pas seulement un psychologue du comportement : il était un chercheur en comportement. Après son arrestation, il commenta : « Cela lui convient parfaitement, c’est excellent pour lui. Ma femme et moi le gardons constamment sous contrôle. S’il fait ses besoins nous pouvons immédiatement changer le drap afin qu’il ne baigne pas trop longtemps dans l’urine et dans les excréments. J’estime que de nos jours les enfants sont trop gâtés par leurs parents. A mon avis, l’importance du contact physique entre mère et enfant est largement exagérée. Un berceau en verre est de loin la meilleure chose[9] ! »
Nous sommes tous concernés par les rejouements des souffrances de nos contemporains. Cette situation extrême et bien d’autres manifestent nos propres aveuglements.
Le déni d’humanité
La connaissance de ce qu’a vécu Per résonne avec la connaissance refoulée que nous avons tous de notre propre histoire. Le fait que nous l’ayons refoulée n’annule pas la présence vivante de cette souffrance en nous.
L’enfant Per a été utilisé comme objet d’expérimentation, mais quelle est la chaîne des croyances, puis des valeurs qui mène à un tel comportement ? Son père, homme de science, pense que l’importance du contact physique entre mère et enfant est largement exagérée. Qu’a-t-il vécu lui-même dans ce domaine ? Je ne connais pas son histoire, mais il est évident qu’il met en scène un vécu qu’il lui a été interdit et qu’il s’interdit de sentir, de reconnaître et d’exprimer consciemment. Dans ses actes, le déni de son être, son éducation et son instruction sont omniprésents. Les injonctions étaient, sans aucun doute, sans appel. On ne pleure pas. On ne se lamente pas. On ne se plaint pas. On ne se touche pas.
Les parents de Per, convaincus d’être en présence d’un organisme végétatif, réflexif et autres projections, entretenaient ce corps sans aucune reconnaissance de la présence de l’être qu’il incarnait. Ils avaient sous leurs yeux la scène qui les hantaient, mais à laquelle ils ne pouvaient apporter le moindre caractère affectif tant l’interdit de sentir, d’exprimer, d’entendre leurs propres souffrances était intériorisé et implacable.
Pouvaient-ils un instant imaginer que leur propre enfance ait été un enfer ? C’était sans doute, pour eux, pure folie que d’aller là où la remise en cause est inévitable mais insupportable pour leurs propres parents. C’est ainsi qu’ils mimèrent, sans état d’âme, le rapport parental qui leur fut infligé. Ceci est particulièrement vrai pour ceux qui ont un rôle social important à tenir.
Le petit enfant, après avoir subi le déni de son humanité, se voit obligé d’obéir, se voit obligé d’apprendre et de se former sans manifester la moindre hésitation, la moindre critique vis-à-vis de ses instructeurs. Il doit devenir à son tour quelqu’un d’important et – si possible – marquer l’Histoire.
Les parents de Per, comme bien d’autres, sont enserrés dans les principes éducatifs d’une classe sociale. En tant qu’être humain, ils ne peuvent manifester au monde que la monstruosité qui leur fut faite. Il existe un tel tabou sur les souffrances liées au déni d’humanité infligé aux enfants, que les conséquences sur l’affectivité de l’Homme, sur sa sensibilité consciente ne sont nullement prises en compte. Et pourtant, il existe bien un lien entre le déni d’humanité infligé aux parents de Per durant leur enfance et ce qu’ils mirent en scène sur leur enfant.
Les exutoires du passé refoulé.
Prenons conscience d’une autre dynamique. Milly Schär-Manzoli nous informe que cette découverte a fait le tour du monde, suscitant l’horreur et l’indignation[10]. Il se trouve que ces deux sentiments sont – en amont de l’information – déjà présents au cœur du refoulé de chacun. C’est pour cette raison que lorsque cette information touche notre sensibilité, elle déclenche, en même temps que l’expression des sentiments due à l’information présentée, l’expression des sentiments refoulés. Nous devons donc prendre en considération notre actuelle impossibilité de distinguer les uns des autres. L’information est devenue le support de toute l’indignation et de toute l’horreur qui nous habitent. Il en est ainsi pour toute information.
Notre éducation, axée sur le refoulement, nous a imposé comme une vérité ce qui n’est qu’une interprétation du phénomène. Elle nous a entraînés à utiliser les situations présentes comme les exutoires d’un passé qui n’a pas droit de cité. Il est, aujourd’hui encore, difficile de questionner nos parents et de leur exprimer la souffrance de notre enfance. Des malheurs sont bien reconnus, mais nous sommes loin d’une écoute réelle entre générations. C’est pourquoi, sans une introspection personnelle, nous sommes dépendants de ces exutoires. Imaginez la situation et l’impressionnante injustice qu’elle engendre. Cette dépendance aux supports introduit inexorablement l’exigence sur soi et sur les autres. Dans nos vies quotidiennes, nous nous saisissons donc des uns, des autres et de tout ce qui se présente à nous, comme supports au besoin de nous soulager du poids de nos émotions refoulées.
Lorsque l’histoire de Per arrive sur la scène de l’actualité et touche le monde entier, l’horreur et l’indignation ne sont pas portées par la compassion mais canalisées par le jugement et la condamnation.
La condamnation posée sur les passages à l’acte des autres est en réalité la condamnation de l’expression (refoulée) de nos propres souffrances. En me mettant dans les conditions propices à l’accueil de ces dernières, je réalise à quel point ce fait d’actualité me parle de la douloureuse distance que ma mère installa entre elle et moi. La peur, la détresse, l’impuissance s’emparent de tout mon être lorsque je me revis, bébé, enfermée pendant des heures dans une chambre, isolée d’elle et des bruits naturels de la vie. La colère, la rage m’envahissent lorsque je revis le sevrage du sein et l’écœurement dû aux bouillies indigestes. Emprisonnée durant des années, dans l’interdit de réaliser ce que j’avais subi, je ne pouvais pas comprendre l’histoire des autres, rendue incapable de l’accueillir et de voir la chaîne des souffrances et des refoulements qui mène à de tels rejouements.
Nos aveuglements nous enchaînent dans des rôles qui évoluent entre les pôles extrêmes que constituent le personnage de persécuteur et celui de persécuté. Ils suscitent en nous de terribles sentiments de folie, d’impuissance, d’incohérence, de désespoir. Nous en perdons alors le sens de notre vie.
Pourtant la vie est une merveille et l’amour de l’être humain est total.
L’incarnation du mal dans l’esprit scientifique.
Il y a un lien entre ce qu’a subi Per et la formation à l’esprit scientifique. Ses parents s’organisèrent scrupuleusement en fonction des principes qui régissent la recherche dans les domaines de l’expérimentation et de l’observation à des fins de conclusions scientifiques. Ils ont fait un gros effort de rationalité. Comme l’écrit Gaston Bachelard : « Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit. » ce qui implique que « toute culture scientifique doit commencer par une catharsis intellectuelle et affective[11]. »
L’esprit scientifique dénie à l’Homme la présence innée de sa conscience intuitive, de sa vérité et de son amour. Il utilise la raison pour donner au rejouement compulsif une légitimité objective. Rappelons ici que le rejouement a pour dessein le retour à l’état de pleine conscience. Lorsque l’être rejoue des scènes douloureuses, il tente de montrer aux autres et de réaliser pour lui-même ce qu’il a subi. L’interdit de voir, la pression sociale et la répression sous toutes ses formes entravent les prises de conscience et favorisent deux comportements compulsifs distincts et complémentaires. L’un de ces comportements tente d’organiser les relations humaines en fonction des structures propres aux rejouements. Ce qui donne, au niveau collectif, des institutions dominées par le pouvoir et non pas par la sagesse.
L’autre comportement intensifie le refoulement, la maîtrise sur soi et les projections sur les autres. Le refoulement devient tout aussi compulsif que le rejouement. Il engendre l’autodestruction et l’utilisation intensive de boucs émissaires comme exutoire de ce qui n’a pas droit de cité.
Mettons en évidence ces processus. Pour ce faire, voyons encore un autre passage de La formation de l’esprit scientifique de Bachelard :
« Si l’on essaie avec la main d’enfoncer un morceau de bois dans l’eau, il résiste. On n’attribue pas facilement la résistance à l’eau. Il est dès lors assez difficile de faire comprendre le principe d’Archimède dans son étonnante simplicité mathématique si l’on n’a pas d’abord critiqué et désorganisé le complexe impur des intuitions premières. En particulier sans cette psychanalyse des erreurs initiales, on ne fera jamais comprendre que le corps qui émerge et le corps complètement immergé obéissent à la même loi[12]. »
Le concept de « complexe impur des intuitions premières » ou bien celui d’« erreurs initiales » nous éclaire sur la nature de la répression. Il montre le mépris posé sur la précision du comportement de l’enfance face à ses parentes et sur les connaissances empiriques. Les concepts d’erreur, d’ignorance et d’irréflexion, chargés de condamnation, constituent de la part du parent ou de l’enseignant des humiliations visant la spontanéité de l’enfant : cette dernière est la manifestation naturelle de sa conscience pleine et agissante. Les concepts d’erreur, d’ignorance, d’irréflexion et bien d’autres participent à la formation scientifique. Ils infligent à la conscience des blessures qui précipitent la maîtrise du senti, des sentiments et de l’intuition. Une fois cette maîtrise établie, la formation scientifique ordonne une sélection parmi les manifestations de la vie et induit donc des déductions amputées de ses dimensions réelles. Cette manipulation des esprits exprime, en premier lieu et de façon inconsciente, les problématiques refoulées de ceux qui ont émis ces concepts. Leur impossibilité de réaliser leurs rejouements les enferme dans la croyance en la nécessité d’une hiérarchie basée sur l’exercice de la maîtrise et du pouvoir sur les autres. La formation scientifique tente donc de montrer, mais aussi de maintenir dans le présent, la stabilité des rapports de Pouvoir subis dans l’enfance en s’appuyant sur une volonté et une raison coupées de la sensibilité humaine. Ce faisant, l’esprit scientifique institutionnalise une pensée qui encourage des passages à l’acte tel que celui des Kelsen.
L’éducation au refoulement, pratiquée sur des générations, nous a entraîné à transférer sur les manifestations de la vie toutes les souffrances refoulées. Ces dernières se libèrent dans l’écoute, l’amour, la vérité et la conscience de la mère, du père ou des témoins des situations vécues. A défaut, il est toujours temps de s’ouvrir à elles en nous confiant à un ami ou à un thérapeute.
Un esprit scientifique ne peut plus reconnaître en lui ni son refoulement, ni l’importance pour son Êêre de la libération consciente du refoulé. Lorsque Gaston Bachelard parle d’une « catharsis intellectuelle et affective » avant de commencer toute culture scientifique, il préconise la liquidation d’affects refoulés dans le subconscient et responsables de traumatismes psychiques. Or, il ne s’agit pas pour l’être humain de catharsis mais de pouvoir jouir à nouveau de toute l’intensité de sa conscience. Il n’y a pas de libération sans conscience. L’abréaction [13] avorte de son sens si elle ne mène pas à la réalisation consciente de l’harmonieux et du dysharmonieux. L’Homme ne peut se renier lui-même. Il ne peut pas vivre dans la terreur, la peur et le mensonge. Il ne peut pas tolérer l’inconscience ni l’aveuglement. Il met donc tout en œuvre pour réaliser ce qu’il est en vérité.
C’est ainsi que l’adolescent dont parle Bachelard et qu’il fut certainement, ne pouvait comprendre le principe d’Archimède dans son étonnante simplicité mathématique puisqu’il interposait, entre l’entendement et la démonstration, son besoin impératif de vivre conscient, donc d’utiliser la situation à cet effet. Dès lors, la démonstration se mue en métaphore d’un vécu refoulé cherchant sa réalisation.
Nous sommes loin de la joie de la découverte propre aux petits enfants.
Considérer avec attention les forces en jeu et découvrir les lois qui les régissent ne prend jamais, chez eux, un caractère austère.
Cette joie est porteuse du sens de la vie. Elle s’assombrit dans l’éducation parentale, s’obscurcit dans l’éducation nationale pour s’éteindre dans la rigueur scientifique, dans l’ampleur des rejouements et la complexité de leurs enchevêtrements. Sans ce merveilleux guide qu’est la joie de vivre, l’expérimentation scientifique devient l’arène de jeux sinistres où les recherches sont dominées par un besoin impératif de conscience non reconnu. S’organisent alors les représentations nécessaires à l’émergence chez les témoins de sentiments impossibles à accueillir par les acteurs.
Ce que les adultes en général, et les scientifiques en particulier, ne savent plus, c’est que la conscience intuitive de l’enfant est totale, donc immense. Le contact avec cette dimension de l’enfant les met face à la réduction à laquelle ils s’identifient, mais qu’ils ne tolèrent pas. La décharge est telle qu’ils ne peuvent qu’infliger à l’enfant ce qui les a mis dans cet état, c’est-à-dire le déni de leur humanité et l’éducation parentale et sociale qui en découle. Ainsi, l’esprit scientifique se définit comme étant au dessus de toutes passions, de toutes émotions, de tous sentiments. Il se doit d’être sans état d’âme, impassible, simplement voué à la raison et à la recherche. Il s’agit d’une tentative de maîtrise totale du refoulé et du processus de refoulement. L’émergence des émotions et des sentiments est travaillée dans le sens du refoulement. Cela donne des Êtres humains coupés de leur sensibilité, de leur vérité, de leur conscience et de leur intuition qui ne raisonnent qu’en fonction des conclusions vérifiables de leur prédécesseurs. Cela légitime toute forme d’expérimentation. Mais malgré tous leurs efforts pour s’extraire de leur affectivité et leur tentative d’utiliser toutes les facultés humaines épurées de tout passé, présent et avenir, ils parlent encore et toujours de leurs terreurs, de leur détresse, de leur ignorance, de leurs errances. En témoignent ces quelques lignes de la dernière page de La formation de l’esprit scientifique : « C’est au savant moderne que convient, plus qu’à tout autre, l’austère conseil de Kipling : “Si tu peux voir s’écrouler soudain l’ouvrage de ta vie, et te remettre au travail, si tu peux souffrir, lutter, mourir sans murmurer, tu seras un homme, mon fils.” » Et Bachelard d’ajouter : « Dans l’œuvre de la science seulement on peut aimer ce qu’on détruit, on peut continuer le passé en le niant, on peut vénérer son maître en le contredisant. »
Interprétation et comportement enfantin
Cet hymne à l’aveuglement paternel est un cri d’errance qui soulage momentanément celui qui l’exprime. Chaque mot, chaque phrase transporte jusqu’à nous l’histoire de son auteur. L’enfant qu’il était fut sensible à l’incessant déni d’amour, d’intelligence, de présence, de cohérence posé sur son comportement.
C’est dans ce harcèlement que naît le sentiment d’être sadiquement utilisé. Le sadisme naît là où le rejouement, mu par les terreurs et les interdits refoulés, s’impose, s’installe et se structure dans le présent comme une réalité. Le sabotage est complet lorsque l’enfant, confiant et sûr de lui, est systématiquement déstabilisé dans son humanité au point de se soumettre à des règles qui concernent uniquement les rejouements parentaux et sociaux. L’enfant qui voit s’écrouler en un seul regard le sens de sa vie et qui est soumis au lent et douloureux processus de maîtrise exigée par le père, souffre, lutte et meurt sans murmurer sa souffrance faute d’espace pour le faire. Il est alors à l’image de ce père. Il a tout perdu, hormis d’être le nouveau représentant de cette souffrance familiale et historique en ce monde.
Regardons comment le rejouement s’introduit, s’organise dans les divers groupes sociaux, par exemple par les voies de la vulgarisation de la psychologie de la petite enfance. Il est couramment admis que le bébé cherche à satisfaire ses désirs. Vous pouvez lire dans 3 à 6 ans qu’« à partir de 3 mois, il fait usage de ses émotions comme outil grossier de communication. Par son sourire et ses cris, il fait venir les grandes personnes sur ses positions. Il invente des astuces qui invitent à ce qu’on satisfasse ses besoins. Il apprend ainsi à appeler à l’aide les gens sans lesquels il ne pourrait pas survivre, qui le soignent et pensent à sa place[14]. »
Soudainement, cet être prétendument végétatif semble animé par autre chose que l’instinct, le réflexe et la pulsion. Sa présence et son amour, niés depuis le commencement, ne peuvent œuvrer pour la conscience puisque ces qualités n’existent pas aux yeux de ses observateurs. Dès lors, l’apparition de comportements ne pouvant être attribués à une matière simplement réactive est attribuée à la présence du mal. Le bébé fait usage, fait venir, invente, invite, apprend en un mot, il manipule. On explique d’ailleurs que le bébé est immature, imparfait, instable, insatiable et que la nature est ainsi faite.
Le diable n’est pas loin...
Il faut savoir qu’un adulte appliqué à rejouer sélectionne dans le présent, sans aucune compassion, les éléments nécessaires à la mise en scène de ses rejouements. Il distribue les rôles, interprète, saisit une phrase mais pas l’autre, fait abstraction du contexte, remarque un détail et ne voit pas l’ensemble. C’est selon l’histoire de chacun. Nous sommes tous plus ou moins pris dans cette dynamique.
Sans cet entendement, il peut paraître surprenant de voir avec quelle facilité l’adulte en général et les parents en particulier attribuent à l’enfant la responsabilité de ses prétendues mauvaises actions et dans quel aveuglement cet adulte est plongé, lorsqu’il s’agit de reconnaître le génie de l’être œuvrant sous ses yeux et qui plus est, pour sa libération.
L’adulte sait que l’enfant privé de ses soins meurt. Mais il ne sait plus ce qu’harmonie veut dire. Il ne connaît plus l’enchantement et la jouissance des gestes respectueux de la plénitude de la vie. La relation devient alors, pour l’enfant - otage des rejouements parentaux et sociaux - un lieu d’abandon, de torture, de manipulation, de chantage, de pression, de contrôle et bien d’autres passages à l’acte douloureux. Dans ce cadre et dans ce cadre seulement, le bébé « appelle à l’aide les gens sans lesquels il ne pourrait pas survivre. » Comprenez que le bébé n’a aucune raison d’appeler à l’aide s’il est assuré de la présence nourrissante de sa mère et de son père.
Nous perdons la jouissance d’être ensemble en utilisant, comme lieux de pouvoir, les différences de force, d’expérience et d’autonomie qui existent entre l’enfant et l’adulte. Nous sommes alors dépossédés de cette faculté humaine par notre impératif. Mais humanité et inconscience sont antinomiques. Et la terreur qu’engendre cet état de solitude est telle qu’elle justifie toutes les formes de rejouement. C’est pourquoi le psychologue nous livre à travers les conclusions de son observation, le regard qu’il a subi enfant et dont il souffre toujours.
La sensibilité de nos enfants
Pour réaliser les liens qui existent entre notre besoin impératif de conscience et les dramatiques situations que nous vivons personnellement ou que nous rapportent régulièrement nos journaux, il nous faut réaliser quelque chose d’extraordinaire. Je veux parler de la sensibilité de nos enfants. Elle est la manifestation d’une conscience pleine et spontanée. Elle est la plénitude, la présence, la vérité et l’amour que nous, adultes, semblons chercher désespérément.
Nos bébés nous indiquent toutes les situations dysharmonieuses qu’ils perçoivent en exprimant leur souffrance. Puis ils miment avec une sensibilité et une précision inimaginable les situations douloureuses engrammées en nous, leurs parents. Pour se faire, ils utilisent tous les moyens que leur offre leur développement. Ils nous montrent par le menu ce que nous croyons avoir dépassé mais qui est toujours refoulé et encore agissant. Ils nous montrent les voies qui nous permettraient de nous libérer. Pourtant face à cette audace, nous opposons presque constamment un violent refus de nous remettre en cause. Ce refus les emprisonne immédiatement dans ce qu’ils nous reflètent. Ils se voient en général moqués, humiliés puis sommés d’arrêter. Ils doivent se raisonner. Souvent ils sont frappés et parfois rejetés. Ils sont alors identifiés aux comportements, aux pensées, aux sentiments qu’ils expriment et finissent par s’y identifier eux-mêmes. Devenus adultes, ils n’auront pas d’autres choix que de remettre en scène les situations dans lesquelles ils ont été émotionnellement, psychologiquement et physiquement enfermés.
J’ai souvent vécu cette merveilleuse expérience où des enfants manifestant une problématique parentale précise changeaient complètement de comportement en sentant que le parent concerné avait saisi le message. Ce dernier, au lieu de s’en prendre à son enfant, s’était centré sur les émotions et les sentiments qui l’envahissaient. Il avait regardé l’ensemble de la situation et se retrouvait pleinement en elle. Il se mit alors à voire ce que d’habitude il s’efforçait à nier. C’est absolument stupéfiant. L’enfant semble alors totalement libéré d’un rôle qu’il présentait parfois depuis des années.
La souffrance refoulée en chacun est omniprésente ; De plus, elle a été, par un jeu subtile de terreurs et de compensations, excessivement complexifiée. L’adulte reste néanmoins au fond de lui plénitude, présence, conscience, amour et vérité. C’est d’ailleurs à partir de ces dispositions naturelles qu’il met en œuvre un processus de libération qui s’activera tant qu’il n’en aura pas retrouvé la pleine jouissance.
Les générations qui nous ont précédés et nous-mêmes sommes nés dans le refus de nos parents de reconnaître ce processus de libération. Ils se sont évertués à humaniser leurs rejouements et à lutter contre leurs conséquences.
C’est ainsi que nous entérinons aujourd’hui les sciences de l’éducation qui excellent dans l’art d’impliquer nos enfants dans les rejouements collectifs, les enfermant toujours d’avantage dans la compulsion. Les éducateurs utilisent leurs sentiments de légitimité pour justifier leurs rejouements et pour escamoter la raison d’être de ces derniers. Ils imposent aux enfants un entraînement intensif au refoulement de leur histoire personnelle et de leur sensibilité meurtrie. Ils les identifient aux projections parentales et sociales. Ils les initient à « l’art » de projeter sur des supports extérieurs les causes et les conséquences de leurs souffrances intériorisées, que ce soient sur la nature (cataclysmes) ou sur des objets fabriqués par l’Homme comme la voiture, ou sur des situations dramatiques comme la pauvreté dans le monde, ou bien encore sur des psycho-classes comme les riches, les pauvres, les partis politiques, les routiers, les ouvriers, juifs, les musulmans, etc, etc, etc... Tout est support. Puis ils présentent la recherche de solutions, compensant matériellement et relationnellement les conséquences de leur aveuglement, comme la panacée universelle avec l’interdiction absolue de mettre à jour les dynamiques qui régissent l’aveuglement collectif.
Malgré toutes les preuves qui nous sont imposées pour nous convaincre du contraire, les Hommes s’activent tous au sein d’un même processus de libération. La méconnaissance de ce processus et du sentiment de légitimité qu’il engendre fait de nos compulsions et de nos compensations quotidiennes des corrosifs qui détruisent le corps humain et le tissu social. Résultat : la communauté humaine éclate en multiples mises en scène exprimant toutes les dimensions d’un Être humain pris dans le refus de sa réalisation.
C’est pour ces raisons que l’organisation sociale de nos compulsions et de nos compensations est à l’origine de certaines situations dramatiques (par ex. : la violence urbaine) qui s’expriment le plus souvent là où les membres de notre communauté ont une histoire refoulée qui les y prédisposent. Et lorsque les tensions engendrées par cette forme d’organisation sociale atteignent un certain seuil et ne peuvent plus être soulagées par la mise en scène d’exutoires, ces dernières prennent l’ampleur de révolutions, de guerres ou de colonisations.
Le rejouement dans l’histoire.
Saisir ce qu’est un rejouement est fondamental. Ses différentes implications ont façonné l’Histoire. Il y a entre les générations et entre les classes sociales des conflits sans merci pour privilégier, sur la place publique, la mise en œuvre de certains rejouements individuels liguant entre eux les membres d’un groupe donné. Nous pouvons également parler de psycho-classes. Ces dernières réunissent des être humains ayant subi des formes analogues de persécution durant leur enfance. Les hommes, les femmes, les enfants, les adolescents, les vieux en tant que groupes, sont des psycho-classes mais aussi les travailleurs, les chômeurs, les enseignants, les médecins, les politiques, de gauche, de droite, les anciens combattants, les prisonniers de guerre, le peuple, la bourgeoisie et la noblesse. Ces regroupements associatifs, corporatifs, partisans, communautaires, religieux ou institutionnels qui se forment et se structurent, unissent leurs membres dans un besoin impératif de reconnaissance et de mise à jour d’un passé refoulé. Ces derniers se confirment les uns les autres et, ce faisant, intensifient leur identification à un rejouement collectif regroupant les principales caractéristiques de leurs rejouements individuels.
C’est ainsi que nous assistons sans relâche à des mises en scène qui s’opposent, s’interpénètrent et explosent en des conflits de diverses intensités. La loi du plus fort règne encore de nos jours à cause de nos aveuglements. Le plus fort physiquement, intellectuellement ou militairement impose ses rejouements à ceux qu’il peut ainsi manipuler. Et comme il y a interdépendance de rejouements entre les dominés et les dominants, nous maintenons en action des situations humainement intolérables par ignorance des enjeux humains réels.
Il est très important de réaliser qu’un sentiment de légitimité accompagne toujours le rejouement. Ce dernier, en tant que révélateur, a pour effet d’apporter, à celui qui rejoue, la profonde assurance d’un comportement justifié. Et ceci, indépendamment d’une prise de conscience. Ainsi en est-il des rejouements considérés comme des évènements antisociaux mais également des scènes de la vie quotidienne. L’agresseur se sent légitime d’agresser et le parent qui estime que son enfant fait un caprice, justifie ses châtiments.
Les légitimations et les justifications sont, au sein des rejouements, diverses et innombrables.
Dans la compulsion, elles soudoient la volonté de redevenir conscient afin d’entériner la mise en œuvre de la hiérarchie sociale à des fins dites de survie.
Le commandement qui stipule de ne point tuer n’est pas la preuve de l’existence du mal en l’Homme. Il pose une puissante barrière psychologique face à la nécessité de rejouer. Le meurtrier, qu’il soit dirigé par la situation (répressions, colonisations, guerres, révolutions) ou qu’il pratique seul, met en scène le meurtre de sa raison d’être. C’est pour cela que l’interdit n’a jamais pu empêcher ce passage à l’acte.
Nous ne pouvons pas faire comme si, à chaque instant, nous sortions de l’intemporalité et évitions sans dommage la rupture des liens de causes à effets. Notre planète et l’Homme sont les héritiers d’un passé inoubliable et inscrit en chacun. Nous pratiquons encore aujourd’hui les valeurs, les croyances et les orientations prises par nos lignées. Et lorsque le drame se prépare, c’est collectivement que nous concourons à sa mise en scène et à son dénouement.
Nous nous révélons à nous-même dans l’introspection, nous réalisons l’histoire des autres dans l’écoute et nous nous connectons avec la véritable histoire de notre humanité à travers toutes ces reprises de conscience. Sans ce travail d’ouverture à soi et à l’autre, il est difficile d’exercer notre discernement parce que nos paniques et notre compulsion à compenser nos manques d’être nous font prendre la légitimité de rejouer pour une approbation.
Si, en tant que metteur en scène et acteur de nos rejouements, nous nous sentons légitime, il se trouve que lorsque la scène est achevée et qu’elle n’a pas porté ses fruits de conscience, survient un malaise existentiel relativement insupportable. Ce dernier nous précipite dans des enchaînements complexes de rejouements compulsifs, de compensations illusoires et de dépressions aux multiples appellations. Cette course en avant essaie tout simplement de fuir un processus naturel de libération. Notre essence est jouissance, paix, amour, conscience. Ce n’est pas la nature, ni le règne animal qui blessent notre sensibilité. C’est à l’endroit où celle-ci nous permet de reconnaître instantanément les dissonances relationnelles que se situe le traumatisme. Ces dissonances forment des empreintes douloureuses que nous appelons souffrances. Au lieu de réaliser l’essentialité qui les anime en les accueillant, nous nous obstinons le plus souvent à les contenir et donc à perpétrer les mêmes mises en scène, les mêmes projections et à utiliser les mêmes supports pour nous soulager. D’où un malaise existentiel insondable.
L’enfant, une invitation constante à la libération
L’amour de l’enfant est tel qu’il est pris de compassion face à la souffrance de ses parents et de ses contemporains. C’est cette compassion qui est prise en otage par la façon que les parents ont d’administrer leur détresse. L’enfant montre le chemin de la libération en exprimant le sien. De par sa spontanéité, l’enfant permet à ses parents de sentir, ressentir, redécouvrir leurs souffrances relationnelles. Mais l’enfant s’identifie aux retours parentaux lorsqu’il est confronté à la terreur qu’ont sa mère et son père de s’ouvrir à leur véritable nature. Les parents s’imaginent protéger leur enfant en refoulant et en cherchant des exutoires. Ils ne pensent pas pouvoir vivre cette relation comme un véritable chemin de libération. L’enfant est pourtant, de par sa sensibilité et sa proximité, le plus à même de pointer toutes les dissonances. Ainsi les parents ont la possibilité de réaliser qu’en eux sont des souffrances qu’ils peuvent écouter et dont ils peuvent se libérer en les accueillant pleinement. C’est dans cet accueil que le regard change. Le parent peut enfin voir l’utilisation qui a été faite de lui donc l’utilisation qu’il fait de son enfant dans ses rejouements. Il peut voir l’injustice qu’il a subie face au refus de ses propres parents de redevenir conscients et donc l’injustice que subit son enfant face à son propre refus de redevenir pleinement conscient.
Aujourd’hui, lorsqu’une colère m’envahit alors que je suis en relation avec mes enfants, je la vis comme une remontée émotionnelle. C’est-à-dire comme l’émergence d’une colère qui m’habite et qui trouve dans la situation présente une justification à son expression. Dès lors, je me retire de cette situation dramatique accompagnée d’un(e) ami(e) prêt(e) à devenir le témoin de ma souffrance. Je m’allonge afin de laisser à cette colère un espace d’expression qui me permette de retrouver son empreinte. C’est alors que je réalise que tout ce que j’étais tentée de justifier dans le présent n’était que torsion de la vérité. Je ne peux plus utiliser mes enfants, les condamner, les juger, les rendre responsables des sentiments qui m’envahissent subitement et justifier leur éducation. Je suis avec ma souffrance, avec celle de mes parents, avec leur refus de voir, avec ce qu’ils ont fait de moi et ce qui a été fait d’eux. Tout s’éclaire et dans le présent, tout redevient possible. Je peux regarder mes enfants sans culpabilité, partager avec eux ce que j’ai vu de tous ces processus qui m’habitent. Je me sens aussi disponible pour accueillir les conséquences de mes aveuglements sur leur sensibilité. Je peux reconnaître la subtilité de leur présence à moi, leur amour infini, la façon qu’ils ont chacun de me proposer spontanément une nouvelle possibilité de me libérer.
L’accueil qu’ils me font lorsque je reconnais être dans une remontée, un rejouement ou une projection est à la mesure de leur amour et de leur conscience. La relation se libère rapidement et la joie de vivre est là, dans les regards, les paroles et le comportement. Nous sommes ensemble. Il n’y a pas, entre nous, la lourdeur des non-dits ni la charge des rancœurs.
Avant d’être mère, j’avais accueilli certaines blessures, ce qui me permit d’offrir à mes enfants une autre enfance que la mienne. J’avais revécu l’expulsion dans ce qui aurait dû être un processus naturel de naissance, le coup sur les fesses et le déchirement dans les poumons. J’avais revécu l’angoisse et les profonds sentiments de perte, d’abandon lors du sevrage, à trois mois. J’avais revécu la terreur des colères de mon père, l’inquiétude durant la dépression de ma mère, le sadisme du médecin. Je n’avais pas encore fait certains liens comme celui qui explique l’ambiance dans laquelle vivaient mes parents et grands-parents au regard de ce qu’ils endurèrent pendant la guerre de 39/45. Je n’avais pas réalisé la projection, le rejouement, l’identification. C’est dans les yeux de mes enfants que j’ai croisé ma conscience et dans leur amour que j’ai pu encore et encore remettre en cause mon attitude et aller voir ce qu’elle me disait de mon histoire. L’importance de ce travail est considérable et incontournable. Nous en sommes arrivés à un tel état de refoulement que nos enfants ne le supportent plus au point d’être de plus en plus malades, parfois d’en mourir, voire de ne plus pouvoir naître.
Le malaise existentiel est, tout comme la souffrance, un appel de l’être à redevenir pleinement soi. Il nous interpelle dans notre rapport à nous-mêmes. Plus nous essayons de le combattre en le refoulant, le rejouant, le distrayant ou l’annihilant avec des drogues et plus il manifeste sa présence. Aujourd’hui, il envahit le monde parce que notre conscience EST et que le déni de son existence ne peut en aucun cas réduire ses activités.
Auto-réduction collective
Notre inclination à fuir ce malaise nous amène à socialiser nos rejouements. Nous revendiquons leur organisation au niveau de la communauté et vivons nos projections comme des réalités humaines à traiter. D’où la complexité et le nombre grandissant de règles et de lois qui régissent notre société. C’est dans cette autoréduction collective que chacun garantit ses rejouements au sein d’une hiérarchie.
Considérons les deux extrêmes qui hantent notre paysage relationnel : le pauvre et le riche. Le pauvre s’accroche autant à sa condition sociale que le riche car ils ont tous deux besoin de reconnaître et que soit reconnue leur histoire. Le pauvre qui devient riche est une exception exploitée par les média pour susciter l’envie dans une population frustrée, et créer la confusion dans les esprits.
Lorsque certaines villes construisirent et organisèrent des refuges pour les clochards, les pouvoirs publics se rendirent compte que ces derniers se sentaient humiliés par le confort des locaux.
Devant le consensus général, il ne reste plus à ces porteurs de malheur que l’expression crue du déni qui leur fut infligé. Il ne suffit pas, pour eux, de s’asseoir dans un fauteuil, de dormir dans un lit et de manger une soupe pour être libérés du poids d’un vécu amplifié par les rejouements historico-collectifs. Comme les dramatiques conséquences occasionnées par la hiérarchisation et aujourd’hui la mondialisation du pouvoir n’ont pas encore été reconnues, le confort affiché de ces refuges ne pouvait être ressenti par eux que comme un déni de leur malheur. Il me semble que seule la prise de conscience du plus grand nombre pourra un jour faire qu’ils se sentent suffisamment entourés et confiants pour oser accueillir les souffrances de leur terrible parcours.
Ce qui est vrai pour les clochards l’est aussi pour les riches. Au lieu de nourrir des illusions et de les enfermer à l’intérieur de ces dernières, écoutons plutôt leur enfance. Celle de Rosemary Kennedy, la sœur de John Kennedy, met en évidence une terrible souffrance parentale. Voici ce que nous apprend Milly Schär-Manzoli : « Son père Joe et les psychiatres la considéraient comme “agressive” parce qu’elle avait un caractère exubérant. Elle était très belle et toujours entourée d’une cour d’admirateurs. Rosemary, qui souffrait de dyslexie, était malgré cela une jeune femme cultivée et intelligente. Comme l’explique le Dr. Roberto Cestari, la dyslexie n’empêche pas de mener une vie normale et d’avoir du succès. Qu’il suffise de penser au grand Einstein qui était dyslexique, tout comme l’étaient Edison, l’écrivain Christian Anderson et d’autres personnalités célèbres. Mais le père de Rosemary, sans doute parce que sa fille était trop vive et qu’il craignait qu’elle ne nuise à la réputation des Kennedy, voulut “calmer” son exubérance juvénile au moyen d’une lobotomie. Celle-ci fut pratiquée par un psychiatre de confiance. La jeune fille passa le reste de son existence sans pouvoir redresser la tête; elle avait perdu toute capacité de s’exprimer et ne comprenait plus rien. Elle mourut dans le courant des années 80, oubliée de tous[15]. »
Qu’ont vécu, enfants, les parents de Rosemary pour être ainsi déconnectés de la réalité ? Tout comme ceux de Per, ils ne peuvent manifester au monde que la monstruosité qui leur fut faite.
Il n’y a pas, en réalité, deux classes sociales mais des humains qui mettent en scène un rejouement collectif auquel chacun prend part en fonction de son histoire. Tout un apparat est organisé et largement médiatisé pour masquer les conséquences et protéger les coulisses.
L’idéalisation posée sur notre organisation sociale
L’idéalisation posée sur notre organisation sociale montre la tendance générale à vouloir se rassurer en perpétrant chaque jour les mêmes schémas relationnels : ceux dans lesquels nous avons grandi et que nous rejouons compulsivement sans même imaginer qu’ils ont une quelconque incidence sur les événements dramatiques qui nous entourent. L’idéalisation paralyse l’appréhension que suscite la simple évocation d’une remise en cause. Ne confondons pas cette dernière avec l’autocritique : humiliante conséquence d’une éducation basée sur l’aveu de nos prétendues fautes. Se remettre en cause, c’est, tout d’abord, avoir encore une certaine confiance en soi, en la vie. C’est pouvoir saisir les choses dans leur ensemble. C’est se donner humblement mais dignement les moyens de voir que notre comportement d’aujourd’hui est inspiré par une force intérieure en laquelle nous reconnaissons la volonté de résoudre nos souffrances. C’est aussi pouvoir percevoir que nos rejouements sont la cause d’événements douloureux, et donc que les rejouements des autres, principalement ceux des parents, ont pu être douloureux pour soi et à l’origine des drames que nous vivons. C’est réaliser la chaîne des causes et des effets, non pas dans le but de chercher des coupables mais dans celui d’expérimenter dans la joie toutes les dimensions de notre merveilleuse humanité. L’idéalisation est formée de notre propre capacité à manipuler la réalité en y projetant, à l’endroit de notre refus de la voir pleinement, des images, des situations, des intentions compensatrices. Cette réalité recomposée compense les souffrances que provoque en nous l’instant présent. Ce lieu à haut risque émotionnel est impossible à appréhender dans toute sa crudité. L’idéalisation manifeste notre terreur face à la vie et la profondeur de notre souffrance.
La démarche qui consiste à accueillir nos souffrances et à retrouver notre humanité est considérée, par les vieilles générations, comme une faiblesse. Elle est raillée de multiples façons, voire, aujourd’hui, condamnée et persécutée. Les arguments sont toujours les mêmes. Ils peuvent se résumer ainsi : il faut se blinder car nous vivons dans une véritable jungle où règne la loi du plus fort. Mais les « plus forts » ne sont que des Êtres humains qui imposent à d’autres leur scénario de vie pour la même raison qui amène, plus ou moins, chacun à le faire. La « jungle » est donc une métaphore qui cache les agissements de refoulés plus violents que les autres et leurs conséquences.
Croire que nous avons la liberté de ne pas nous remettre en cause procède d’un leurre. Et croire que nous puissions ne pas être directement concernés par le pouvoir en place l’est tout autant. L’homme refoulant sa souffrance cherche sans cesse un pouvoir aussi fort que celui qu’il utilise pour refouler et maîtriser son monde intérieur. Il le crée donc et est convaincu de la nécessité d’une hiérarchie qui installe et maintienne ce pouvoir.
Le pouvoir doit être sécurisant. Ce qui signifie qu’il ne remettra pas en cause le système de refoulement de ses membres et qu’il défendra leurs besoins compulsifs de compenser et d’organiser plus humainement leurs rejouements. Mais, pour ce faire, les Hommes sont obligés de mettre en scène le prix qu’ils font payer à leur intégrité, à leur authenticité, à leur liberté. Ils structurent donc cet ensemble dysharmonieux, en organisant le lynchage collectif de ceux qui manifestent encore cette part sacrifiée d’eux-mêmes. Et c’est au nom de la survie du groupe que le pouvoir élimine ceux qui régulièrement provoquent sa remise en cause.
Projections collectives et passages à l’acte
Les Hommes ont donc pratiqué diverses formes d’exutoires, indispensables au maintien du refoulement collectif. Sur la base du transfert individuel se sont organisés des transferts de groupe qui ont désigné les porteurs de la douloureuse problématique refoulée en chacun. Les Juifs avaient leurs boucs émissaires, les démocrates grecs avaient leurs esclaves, les Romains, leurs Chrétiens. Certaines grandes civilisations pratiquèrent des sacrifices humains, d’autres parquèrent les pauvres et les malades. Les Tziganes et les Bohémiens étaient pourchassés, les intouchables mis à l’écart. Il y eut les génocides, les exterminations d’opposants religieux et politiques, l’enfermement des simples d’esprits, des fous, des handicapés, et sous diverses formes, celui des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et des vieux. Chaque époque a connu ses exclusions et ses exécutions.
Si les Tsiganes représentent, pour certains, la liberté, pour d’autres, beaucoup plus nombreux, ils menacent l’ordre établi. Les projections faites sur ces gens nous parlent de ceux qui projettent. Elles nous retracent la condamnation et la répression exercées sur leur propre conscience. Les forces déployées pour maîtriser, posséder, exploiter, rejeter ou exterminer certains groupes humains ou certaines civilisations témoignent des extraordinaires forces intérieures mises en œuvre pour maîtriser, posséder, exploiter, rejeter ou tenter d’exterminer la spontanéité de la conscience de l’Homme.
Les projections répondent aux injonctions du groupe. Ce dernier rejoue sans se demander en quoi ce qu’il projette relève de son refoulé.
En quoi les sacrifices humains concernaient-ils les civilisations qui les pratiquèrent ? Que sacrifiaient-ils en eux ?
En quoi les massacres des premiers chrétiens concernaient-ils les romains ? Que massacraient-ils en eux ?
En quoi la soumission à la puissance absolue d’un maître concernait-elle les esclavagistes ? Que soumettaient-ils en eux ?
Que fuyons-nous pour que les pauvres, les malades, les handicapés, les fous, les vieux et les jeunes soient écartés de la population active ? Nos rejouements réduisent notre amplitude comme une peau de chagrin. Ils éclatent notre communauté en catégories sociales, nous séparant les uns des autres au point de ne plus savoir être ensemble. Nous faisons ceci pour échapper aux sentiments de pauvreté intérieure, de mal-être, de handicaps, de gâchis, de folie qu’engendre la non-résolution de nos rejouements. Nous fuyons ces sentiments comme nous essayons d’échapper aux remontées émotionnelles et aux remises en cause que leurs différents états provoquent.
La réceptivité de l’Homme est infinie. Sa sensibilité est son guide et le dispense de tout ordre, de toute hiérarchie, de tout pouvoir. Elle est entièrement présente à toute la création. Cette amplitude subtile ne supporte aucune restriction, aucun revirement. C’est pourquoi le refoulement engendre une souffrance psychologique dont nous chercherons sans cesse la résolution. L’enjeu d’une telle recherche n’est pas tant de se libérer de la souffrance elle-même que de revivre ce puissant hymne à la vie que nous sommes et que nous appelons bonheur, bien-être, ravissement, béatitude. Vivre intensément, ce n’est pas flirter avec la mort mais c’est jouir consciemment et pleinement de l’être que nous sommes.
Pour refouler, il faut inverser l’exercice de nos dispositions naturelles au profit du refoulement. Ce qui veut dire que ces facultés sont utilisées pour refouler et pour se libérer de ce refoulé. Notre rapport à elles est alors modifié en fonction de cette nécessité. Nous les discernons, les possédons, les hiérarchisons, les exploitons dans cette optique de libération. Mais pendant tout ce temps, nous sommes dans l’impossibilité de jouir pleinement de notre vie. Et la compulsion de répétition nous enferme dans ce processus dynamique. C’est pourquoi l’éducation au refoulement finit par réduire notre expression aux seuls rejouements qui concernent notre refoulé.
L’Homme est un tout indivisible. Il ne peut s’extraire de sa totalité. Il ne peut pas se vivre à moitié. Tout est toujours là. Pour manifester sa souffrance, il n’a pas eu d’autres choix que de s’utiliser lui-même puis d’utiliser les autres et son environnement. Il a donc différencié ses propriétés, ses qualités et ses sentiments afin de les hiérarchiser dans un système de valeurs et ainsi donner vie à son chemin de libération. Le bien et le mal sont les fruits de ce processus.
L’Histoire, notre histoire
Regardons l’Histoire de l’Homme dans son ensemble. Elle nous montre l’évolution de notre rapport à nous-mêmes. Je me sens toujours concernée par les différentes évocations de la problématique humaine. Le sacrifice humain ritualisé me parle du sacrifice des caractéristiques essentielles qui définissent notre humanité. Il s’agit d’un passage à l’acte collectif fait au nom de la structuration hiérarchique de l’ensemble du groupe concerné. C’est le sacrifice de notre spontanéité consciente mise sous la tutelle du contrôle parental et de la hiérarchie sociale. Face à ces lynchages, le groupe vit de tels traumatismes que les Hommes chercheront à devenir responsables de leurs rejouements et donc à en assumer les conséquences. D’où la tendance constante d’humaniser les rejouements compulsifs et de nous responsabiliser par rapport à une réalité aujourd’hui essentiellement constituée de leurs conséquences.
La persécution des Chrétiens nous parle de celle que les Romains se faisaient subir. Cette domination, ce pouvoir qu’ils exerçaient d’abord sur eux-mêmes nécessitaient pour leur maintien la mise en scène du massacre de leur vérité et de leur spiritualité. L’un ne pouvait aller sans l’autre. Il n’y a pas de retournement dans le comportement humain sans la manifestation de ce qui est réprimé à cet effet. Les Romains voyaient chez les chrétiens des qualités qu’ils s’appliquaient à dévaloriser. Ils laissèrent libre cours à la manifestation de ce qu’ils se faisaient subir à eux-mêmes sans se questionner sur la légitimité de leurs actes.
La mise en scène de l’esclavage nous montre notre tentative désespérée de maîtriser totalement notre sensibilité au profit d’une raison qui accorde la suprématie au pouvoir. Elle nous montre notre rapport à la satisfaction de nos besoins naturels et nos exigences en matière de compensation. Ce ne sont que des exemples qui tentent d’éclairer l’activité d’un processus encore méconnu.
La négation de l’existence de l’Être sensible que nous sommes est la toile de fond de la socialisation. Sur ce déni, l’enfant est invité à refouler, à se maîtriser, à se discipliner, à s’illusionner donc à adhérer à un système.
Depuis des siècles, nous sommes effrayés par les actes que nous commettons au nom de nos rejouements, par leurs conséquences et par l’ampleur du déni que nous faisons supporter à notre amour en devenant des êtres compulsifs.
Imaginez des acteurs qui s’identifieraient à leur rôle, le temps d’une pièce comme celle d’Oedipe Roi. Ils passeraient d’une représentation symbolique à une scène réellement vécue. Les témoins ne supporteraient même pas le début de l’histoire. Pourtant, c’est ce qu’ils font dans la vie quotidienne : supporter. La différence de comportement provient du fait qu’à l’endroit du théâtre tout le monde sait que c’est une mise en scène, mais dans la vie courante, personne ne veut le savoir. Nos rejouements sont pourtant des représentations que nous nous offrons à nous-mêmes et offrons aux autres, dans le but de nous libérer du refoulé et de retrouver notre sensibilité consciente.
La distance, qui aurait pu permettre au spectateur de réaliser les processus et les dynamiques qui agissent l’Homme, est, au théâtre comme dans la vie de tous les jours, envahie par un enchevêtrement complexe d’attitudes réactives, d’identifications et d’émotions qui surgissent dans le présent. Elle est surtout dominée par une revendication qui écarte ou minimise l’éventualité d’une identification et qui veut que seul le présent soit la cause des émotions qui s’y expriment. Dès lors, il devient difficile de mettre à jour la stérilité des exutoires en matière de conscience.
Si des acteurs s’identifiaient à leur rôle, leurs camarades et le public ne pourraient pas rester immobiles et silencieux. Ils ne pourraient pas se dire dans leur for intérieur « c’est la vie », sachant qu’à tout moment, ils pourraient leur rappeler qu’ils jouent un rôle et qu’ils ont une responsabilité vis-à-vis de la conscience collective. Le Roi Laïos et son épouse Jocaste ne pourraient pas ordonner d’exposer leur nouveau-né dans la montagne et le serviteur ne pourrait pas lui percer les chevilles afin de les lier l’une à l’autre. Si ces trois protagonistes tentaient de le faire, ils apparaîtraient dans toute leur réduction. Les acteurs ne peuvent qu’interpeller les spectateurs pour que ces derniers puissent réaliser certaines caractéristiques qui dominent leur mode relationnel comme jouer un rôle, installer un rejouement, refouler, être envahi par une émotion et leurs voies de libération, comme par exemple l’écoute, l’expression des sentiments et surtout l’acceptation d’une remise en cause face à une conscience qui se détache d’une large représentation des valeurs et des croyances sociales de l’époque.
Seulement voilà que les spectateurs d’aujourd’hui, sachant qu’ils sont devant une mise en scène fictive, utilisent – sans en être conscients – la situation pour revivre des sentiments d’impuissance au lieu d’utiliser la distance que permet le spectacle, pour réaliser quelque chose d’essentiel. La raison en est que nos enfances sont remplies de situations où nous avons été les témoins impuissants de scènes douloureuses. Notre sensibilité ne pouvant jouir d’un tel spectacle, elle garde à la mémoire l’ensemble du traumatisme (circonstances et souffrances) et comme ici, tentera de résoudre cette empreinte en la réactualisant dans le présent.
Les injonctions des adultes, les humiliations, les injures, les punitions, les coups portés sur nous-mêmes, sur nos frères et sœurs ou sur d’autres enfants voire sur des adultes, vécus dans l’interdiction d’intervenir, de se rebeller ou même d’exprimer son indignation, font de nous, devenus adultes, des spectateurs impuissants devant des scènes à hurler qui nécessiteraient une intervention consciente des témoins.
Une terrible tragédie
C’est alors que tous les protagonistes du spectacle jouent ensemble une terrible tragédie. Celle de l’édification de l’aveuglement compulsif du plus grand nombre.
Le théâtre, ce chef-d’œuvre du génie humain, avait pour but d’offrir le recul nécessaire pour nous permettre de retrouver notre faculté de jouir de la conscience. Les novateurs de cette forme d’expression jouaient des tragédies. Intuitivement, ils sentaient que la problématique humaine se trouvait à l’endroit des souffrances de l’Homme, de ses errances, de ses répétitions. Les thèmes représentaient quelque grand malheur arrivé à des personnages célèbres ou de l’histoire. Ces derniers étaient déjà les représentants d’une mise en scène quotidiennement rejouée. Ce processus projectif et sa mise en application rappelait à chacun le pouvoir constamment agi en lui. Chaque autorité en place (administrative ou religieuse) remémorait au plus grand nombre les diverses facettes d’un pouvoir sur soi intériorisé. La gamme s’étendait de la manifestation d’une volonté de soumission totale de l’Être face aux représentants de cette autorité aux vénérations les plus extraordinaires de la grandeur de l’Homme projetée sur des dieux. L’évolution du pouvoir au cours des siècles nous parle de l’évolution de notre propre structure égotique. Et le théâtre nous montre ce rapport à nous-mêmes.
Lorsque les novateurs mirent les représentants du pouvoir face à leurs rejouements, c’était l’ensemble de la communauté concernée qui était face à elle-même. Mais dans une conviction intuitive que la remise en cause est synonyme de la perte de ce pouvoir, de témoins d’eux-mêmes, tous devinrent spectateur. Dès lors, leurs successeurs, inconscients des enjeux de leur entreprise et pris dans leurs propres rejouements, acceptèrent comme objectif premier, non plus la conscience, mais les aspects cathartique, attractif et même révolutionnaire d’une œuvre. Au cours des siècles, le théâtre évolua donc dans ce sens, humiliant ainsi toutes tentatives et toutes propositions de libération. Les œuvres cathartiques soulageaient le public de tensions accumulées dans le quotidien. Les œuvres distractives lui faisaient oublier ses misères, ses errances et quand celles-ci ne pouvaient plus être écartées, le spectacle devenait révolutionnaire.
En général, le spectacle révolutionnaire dresse, par maintes caricatures, deux classes sociales l’une contre l’autre : les sujets contre la noblesse, le peuple contre la bourgeoisie ou le pauvre contre le riche. Aujourd’hui, il ne s’agit plus de distinguer et d’opposer deux classes sociales en fonction de leurs différends mais bien de regarder l’ensemble de la situation pour réaliser les processus qui leurs donnent corps. Le racisme de classes a longtemps ébranlé l’Histoire. Il n’a jamais permis de mettre à jour l’origine du pouvoir ni permis la résolution des problèmes qui en découlent. Car le pouvoir est occasionné par le maintien du refoulement de la souffrance en chacun. Il n’est rien d’autre que cette manifestation.
En politique, il n’a jamais été question de résoudre le problème du pouvoir et de sa hiérarchie mais bien de maintenir ces derniers tout en s’efforçant de trouver des solutions à leurs conséquences. C’est l’art de tourner en rond en nourrissant ce que l’on prétend combattre. Dans ce domaine, il n’y a pas d’introspection individuelle ni collective, il n’y a pas d’écoute. Il y a la recherche du statut social et celle du profit. Il y a la concurrence donc la répression qui engendre la révolte. Je trouve très encourageant de considérer le pouvoir en place comme un rejouement collectif, car cela permet de le situer précisément dans nos histoires personnelles et dans notre histoire collective. Nous pouvons ainsi entrevoir le bout du tunnel.
Dans cette vision du déroulement de l’Histoire, chacun est placé face à la souffrance humaine, face à lui-même et non plus armé contre l’autre.
La métamorphose
Le témoin, tout comme l’enfant, reste conscient et compatissant. Il reste sensible et saisit la situation dans son ensemble. Mais une éducation basée sur le refoulement le poussera à projeter sur tel ou tel personnage et sur telle ou telle situation ses propres souffrances. Ces dernières, échafaudées en identifications et interprétations de toutes sortes, viennent, par projections interposées, fortement colorer le présent du passé. Y règnent alors nos propres combats intérieurs.
De témoin, l’Homme s’est transformé en un spectateur avide de situations qui excitent ses multiples traumatismes refoulés. Aujourd’hui, l’habileté du scénariste et celle de l’acteur cibleront la sensibilité du spectateur de telle façon que ce dernier soit touché sans toute fois provoquer chez lui une réelle remise en cause de ses habitudes de pensées et d’actions. Ils utiliseront alors l’humour, l’ironie, le drame, la comédie ou la provocation pour aboutir au résultat escompté par les deux parties. Le spectateur, attaché à ses refoulements et las de ses infructueuses représentations quotidiennes, réclame compulsivement une énorme production de situations diverses aux gens du spectacle. Ce faisant, tous s’écœurent sans savoir pourquoi. Ce faisant, tous se retrouvent face à la subtile manipulation de leur sensibilité au profit du pouvoir. Le spectateur cherche des espaces où il n’a plus la responsabilité de la mise en scène. Il peut même se faire croire que les émotions que la représentation réveille en lui, n’ont aucune existence en dehors du spectacle. Cette impressionnante dérive de la raison est due à la terreur que nous avons de vivre pleinement notre humanité.
Sylvie Vermeulen
© S. Vermeulen – 01.2002/ regardconscient.net
Notes :
[1] Nicolas Malebranche, Les entretiens sur la métaphysique - le péché originel et ses conséquences (1688), cité par André Vergez et Denis Huisman, in Histoire des philosophies, éd. Nathan, 1966, p. 154.
[2] Entretien avec Elisabeth Roudinesco, propos recueillis par Antoine Artous, Rouge No 1843.
[3] Anatole France, L’Église et la République, éd. J.-J. Pauvert, 1964, p. 35.
[4] Cité par Anatole France, ibid., p. 26.
[5] Décret du 17 mars 1808.
[6] Yves Gaulupeau, La France à l’école, éd. Gallimard, 1992, p. 95.
[7] Expression empruntée à Alain Guillotte, 3 à 6 ans, l’enfant metteur en scène de sa vie, chronique sociale de France, coll. Éveil, Lyon 1986.
[8] Alain Guillotte, ibid., p. 4.
[9] Cité par Milly Schär-Manzoli, Crimes médicaux, cobayes humains, éd. ATRA, Casa Orizzonti, CH-6517 Arbedo, 1998, pp. 11-16.
[10]) Ibid., p. 13.
[11] Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, librairie philosophique J. Virin, p. 18.
[12]) Ibid., p. 18.
[13] Terme psychanalytique : réaction d’extériorisation par laquelle un sujet se libère d’un refoulement affectif.
[14] Alain Guillotte, ibid., p. 4.
[15] Milly Schär-Manzoli, Crimes médicaux, cobayes humains, éd. ATRA, Casa Orizzonti, CH-6517 Arbedo, 1998, p. 23.
