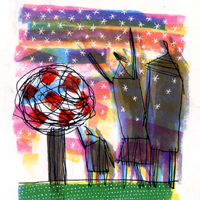Psychothérapies
La dépression ou l’art de se leurrer
par Alice Miller*
Résumé : La dépression est la conséquence de l’évitement de toutes les émotions reliées aux blessures de l’enfance. Dans une société qui fonctionne sur le déni de ces souffrances et se tient toujours du côté des parents, il est rare de trouver une personne éclairée pour confirmer l’importance de ce vécu précoce.

Depuis ma jeunesse, l’écrivain russe Anton Tchekhov compte parmi les auteurs que je préfère. Je me souviens très bien de l’appétit avec lequel j’ai, vers l’âge de 16 ans, dévoré son récit La salle No 6, et de l’admiration que j’éprouvais pour l’acuité de son regard et la finesse de sa psychologie, et plus encore pour le courage avec lequel il aborde la vérité et la donne à voir, sans chercher à épargner quiconque lui est apparu comme une crapule.
Tchekhov, le despotisme et le mensonge
C’est seulement beaucoup, beaucoup plus tard que j’ai lu sa correspondance et que j’y ai trouvé, ainsi que dans les biographies qui lui sont consacrées, des informations sur son enfance. Il m’est alors apparu que ce courage de dire la vérité, que j’admirais tant chez Tchekhov, trouvait ses limites dès que son père était en cause. Voici ce que dit de lui sa biographe Elsbeth Wolffheim :
« À l’école, il était rabaissé et humilié, mais ce n’était rien à côté de ce qu’il subissait à la maison. Le père de Tchekhov était irascible et grossier, il traitait ses proches avec une rigueur extrême. Les enfants prenaient des raclées presque tous les jours, ils devaient se lever à cinq heures du matin, aider au magasin avant l’école, recommencer après, si bien qu’ils trouvaient à peine le temps de faire leurs devoirs. De plus, en hiver, il faisait un froid glacial dans le sous-sol où le magasin était installé, au point que l’encre y gelait. Jusque tard dans la soirée, les trois frères servaient les clients tout comme les jeunes apprentis, ils étaient battus par leur patron comme eux et parfois, debout, s’endormaient d’épuisement. Le père […] prenait part avec un zèle fanatique à la vie de la paroisse, il dirigeait le choeur, et ses fils devaient y chanter[1]. »
Tchekhov écrivit un jour que lorsqu’il chantait dans ce choeur, il se sentait comme un déporté en camp de travail[2], et dans une lettre à son frère, il lui suffit de quelques lignes pour tracer de son père un portrait conforme à la vérité, mais cette vérité semblait ne trouver aucune place dans sa vie : « Le despotisme et le mensonge ont gâché notre enfance au point de se sentir mal et d’être pris de peur lorsque le souvenir remonte[3]. » De telles affirmations sont extrêmement rares, le fils s’est préoccupé toute sa vie, au prix de lourds sacrifices financiers, de l’entretien de son père. Pour ce qui est des sacrifices psychiques qu’il a également consentis en réprimant sa vérité propre, personne dans son entourage n’en a eu la moindre idée, parce que l’opinion générale était qu’il y avait de la vertu à se comporter ainsi. Pourtant, le refoulement des sentiments authentiques en relation avec les traitements épouvantables infligés à l’enfant a nécessité beaucoup d’énergie et pourrait bien avoir déclenché la tuberculose que Tchekhov a attrapée très tôt, ainsi que ses accès de dépression, que l’on appelait alors mélancolie. Il mourut finalement à l’âge de 44 ans[4].
La lecture du livre récemment paru de Ivan Bounine, Tchekhov, m’a appris que mes réflexions peuvent être confirmées par les paroles de Tchekhov lui-même. Il exprime ici des louanges à l’égard de ses parents, bien qu’il ait parfaitement dû savoir quel travestissement il infligeait ainsi à la réalité :
« Mon père et ma mère sont les seuls êtres au monde auxquels je ne refuserai jamais rien. Si je réussis un jour dans ma vie, je le leur devrai entièrement. Ce sont des gens merveilleux. L’amour infini qu’ils portent à leurs enfants les place au-dessus de tout éloge, efface tous les défauts [qu’a pu développer en eux une existence trop dure, NDT][5] »
D’après Bounine, Anton Tchekhov aurait même à plusieurs occasions souligné ce point devant des amis : « Je n’ai jamais enfreint le quatrième commandement[6]. »
Dalida, la trahison du vrai Soi
Trahir ainsi ce qu’on sait intimement n’a rien d’exceptionnel. De la même façon, beaucoup de gens passent leur vie à nourrir sur leurs parents des jugements complètement faux, à cause d’une peur refoulée, la peur du tout petit enfant devant ses parents. Cette trahison de leur vrai Soi, ils la paient par des dépressions, des suicides ou des maladies graves, qui sont facteurs de mort précoce. Pour ce qui concerne les suicides, on retrouve presque à chaque fois des épisodes de l’enfance extrêmement traumatisants qui ont été totalement niés ou qui n’ont jamais été reconnus comme tels. Tous ces gens ne voulaient rien connaître de leurs souffrances précoces et vivaient dans une société qui ignore tout autant ces souffrances. La place accordée à l’histoire individuelle de l’enfant et à son importance pour sa vie ultérieure a toujours été nulle ou beaucoup trop faible, et il en est de même aujourd’hui encore. Voilà pourquoi tout le monde s’étonne quand par exemple une vedette très en vue se suicide et qu’il est alors révélé qu’elle souffrait de dépression. Il ou elle avait pourtant tout ce que tant d’autres aimeraient tellement avoir, c’est ce qu’on entend alors de tous côtés, qu’est-ce qui a donc bien pu lui manquer ?
Le décalage entre la réalité refoulée et la façade « heureuse » m’est aussi apparu en regardant un documentaire sur la chanteuse Dalida, qui a souffert pendant de longues années de dépression grave et a mis fin à ses jours à l’âge de 54 ans. Il y a eu un grand nombre d’interviews de personnes qui prétendaient la connaître très bien et l’aimer, et qui étaient très proche d’elles dans la vie privée ou professionnelle. Sans aucune exception, ces personnes ont affirmé que ses crises de dépression et son suicide étaient pour elles absolument incompréhensibles. Sans arrêt revenaient ces phrases : « Elle avait tout ce que l’on désire habituellement : la beauté, l’intelligence, un énorme succès. Pourquoi donc alors ces dépressions à répétition ? »
Le fait que tous les proches de Dalida ne se soient doutés de rien m’a permis de saisir dans quelle solitude, tant intérieure qu’extérieure, la vie de cette vedette a dû se dérouler, et le grand nombre de ses admirateurs n’y a rien changé. J’avais l’intuition que l’on pourrait trouver dans l’enfance de la chanteuse de quoi expliquer son suicide, mais cet aspect n’a été évoqué par personne au cours de l’émission. En cherchant sur Internet, je n’ai rien trouvé d’autre que ce qui est répété partout, c’est-à-dire que Dalida aurait eu une enfance heureuse et des parents aimants. Pourtant, quoi de plus éclairant que la vie des célébrités pour établir à quel point la dépression est répandue. Malgré tout, la question de l’origine, de la racine de cette souffrance n’est presque jamais posée. Du coup, la dépression apparaît comme inévitable et inexplicable. Il y a en particulier une question qui n’est jamais posée : Comment Dalida enfant a-t-elle donc bien pu vivre le fait d’être élevée par des religieuses ?
Comme j’ai lu beaucoup de choses sur ce type d’internats, je sais qu’il n’est pas rare que des enfants doivent y subir des violences d’ordre sexuel, physique ou psychique, qu’il leur faut considérer comme des manifestations d’amour et d’attention, ce qui leur apprend à accepter le mensonge comme une chose normale. Je sais aussi que les tentatives de faire connaître à l’opinion publique les conditions de vie scandaleuses qui règnent dans ces établissements font face à l’obstruction des institutions religieuses. La plupart des anciennes victimes font tout pour oublier les tourments qui leur ont été infligés dans leur enfance, d’autant plus qu’elles savent qu’elles ne trouveront dans la société pour ainsi dire aucun témoin lucide pour prendre leurs souffrances au sérieux. Seule l’indignation de la société pourrait les aider à ressentir leur propre indignation et à se rebeller contre le mensonge. Mais lorsque cette assistance vient à manquer pour ainsi dire à chaque fois qu’elle est sollicitée, lorsque toutes les autorités se solidarisent avec le mensonge, c’est comme si on imposait de force la dépression à ces personnes.
La vie de Dalida, comme celle de nombreuses célébrités, reste mystérieuse, et c’est justement cela qui semble fasciner le public.
Bien des vedettes mondialement célèbres, qu’on les ait jalousées ou adulées, ont au fond été extrêmement seules. Comme l’exemple de Dalida le montre, elles n’ont jamais été comprises, parce qu’elles ne pouvaient pas se comprendre elles-mêmes. Et elles n’étaient pas en situation de pouvoir se comprendre parce que leur entourage ne leur renvoyait pas de la compréhension, mais uniquement de l’admiration. Finalement, elles mirent fin à leurs jours. Ce cycle nous en dit long sur les mécanismes de la dépression. Sur la voie du succès, c’est de la compréhension que ces gens recherchent, ils se donnent un mal infini pour l’obtenir et pour qu’un public toujours plus vaste s’enthousiasme pour eux. Mais cet enthousiasme ne les nourrit pas aussi longtemps que la compréhension leur manque. Alors, malgré leur carrière, la vie n’a finalement aucun sens pour eux, tellement ils restent étrangers à eux-mêmes. Et ils restent étrangers à eux-mêmes parce qu’ils veulent oublier complètement ce qui est arrivé au début de leur vie et nient leurs souffrances précoces. Comme la société toute entière fonctionne de cette façon, ces vedettes ne pouvaient être comprises de personne et souffraient donc de leur solitude.
Marylyn Monroe, charme et dépression
Ce déni complet de la souffrance que nous éprouvons au début de notre vie est lourd de conséquences. Imaginons-nous quelqu’un qui voudrait entreprendre une randonnée et se foulerait le pied dès le début de sa course. Même s’il essayait de ne pas tenir compte de sa souffrance et de poursuivre sa randonnée parce qu’il s’en était fait une joie, les autres vont se rendre compte tôt ou tard qu’il boite. Ils vont lui demander ce qui lui est arrivé. Il leur racontera alors son histoire, ils comprendront pourquoi il boite et lui conseilleront de se faire soigner.
Il en va autrement quand il s’agit des blessures psychiques précoces, qui jouent dans la vie des hommes un rôle comparable à celui du pied foulé au début d’une randonnée. Aucune considération philosophique ne permettra de s’en débarrasser, elles vont peser de tout leur poids sur sa vie, avec cependant cette différence qu’en règle générale personne ne leur accordera d’attention. Sur ce point, la société toute entière est assez d’accord avec la personne qui souffre et qui ne peut pas raconter ce qui lui est arrivé. Il est aussi possible que cet individu blessé dans son intégrité n’en ait aucun souvenir. S’il lui faut passer toute sa vie parmi des gens qui prennent à la légère les traumatismes subis dans l’enfance, il joue le jeu. De ce fait, sa vie se déroulera donc à peu près comme la randonnée d’un homme qui s’est foulé le pied juste au début, mais ne veut pas l’admettre et fait comme si en fait rien ne lui était arrivé. Mais, si d’aventure il rencontre des gens qui ont connaissance des répercussions des traumatismes précoces, il a l’opportunité de rompre avec son déni et d’ouvrir ainsi la voie à la guérison des blessures qu’il a subies autrefois.
Beaucoup de gens n’ont pas cette chance. Car justement, plus ils sont célèbres, plus on trouve autour d’eux des admirateurs superficiels et sans réflexion, et aucun d’entre eux ne mesure la détresse dans laquelle se trouve leur idole, ou n’a ne serait-ce que l’envie de la mesurer. Les exemples ne manquent pas. Que l’on pense à la vie de la merveilleuse Marilyn Monroe, placée en foyer par sa mère et violée à l’âge de 9 ans ; revenue plus tard dans sa famille, elle a été harcelée sexuellement par son beau-père. Jusqu’à la fin de sa vie, elle n’a eu confiance qu’en son charme, si bien que la dépression et les drogues ont eu raison d’elle. Voici en quels termes elle a parlé de son enfance, des phrases que l’on retrouve fréquemment sur Internet : « Je n’étais pas orpheline. Une orpheline n’a pas de parents. Tous les autres enfants à l’orphelinat n’avaient plus de parents. J’avais encore une mère. Mais elle ne voulait pas de moi. J’avais honte d’expliquer ça aux autres enfants là-bas… »
Dangereuse théorie de la résilience
Bien des gens souhaiteraient sans doute que leur propre vie soit une réussite semblable, et ne peuvent pas comprendre pourquoi une star n’arrive pas à en jouir. Quand un individu est particulièrement doué, il peut aussi utiliser ce talent pour renforcer ses mécanismes de défense contre la vérité et la maintenir ainsi éloignée de lui-même et des autres.
Dans ce mécanisme cyclique, une exception est constituée par les gens qui ont subi des traumatismes qui n’ont pas été causés par les parents. Ces personnes ont plus de chances de trouver de l’empathie dans la société parce que chacun peut se représenter ce que cela signifie par exemple que d’avoir grandi dans un camp, ou, pour un otage aux mains de terroristes, d’avoir passé quelques jours dans un état d’impuissance affreux. Alors, ceux qui ont subi de tels traumatismes peuvent s’attendre à être compris, aussi bien par leurs parents adoptifs que par leurs amis ou ce qui reste de la famille, et à ce qu’on leur témoigne de la compassion.
Il est exact d’affirmer que nous possédons en tant qu’enfants de nombreuses ressources qui nous rendent capables de survivre même à des blessures graves. Mais pour se débarrasser de leurs séquelles, nous avons besoin de trouver des témoins lucides dans la société. Cependant, on fera le constat de leur inexistence dans la plupart des cas où les parents sont les auteurs des mauvais traitements. Un enfant qui a subi la maltraitance de ses parents se retrouve adulte sans témoins, et reste de ce fait isolé : non seulement des autres, mais aussi de lui-même, parce qu’il a refoulé la vérité, et que personne ne l’aide à appréhender la réalité de ce qu’il a vécu enfant. Car la société se tient toujours aux côtés des parents. Chacun sait qu’il en est ainsi et du coup, à quoi bon oser s’approcher de sa vérité ? Mais si cette personne arrive à ressentir et à exprimer sa colère dans le cadre d’une thérapie réussie, elle se verra sans doute confrontée à l’hostilité de toute sa famille et de ses amis, qui vont l’attaquer parce qu’elle a transgressé un tabou et que cette transgression fait également peur aux autres. Ces gens peuvent aller jusqu’à employer tous les moyens contre cette personne de façon à pouvoir garder intact leur propre refoulement.
Parmi ceux qui ont survécu à des mauvais traitements précoces, il y en a peu qui sont en état de supporter ces agressions et qui sont capables d’accepter de se retrouver isolés plutôt que de trahir leur vérité. Cependant il est permis d’espérer qu’avec la diffusion de la connaissance de la dynamique émotionnelle de ces processus, les choses changeront, et que grâce à l’éclosion de groupes de personnes plus éclairées, on ne soit plus condamné à une solitude absolue. Voilà pourquoi je considère la théorie de la résilience comme dangereuse, parce qu’elle est susceptible de diminuer le nombre des témoins lucides plutôt que de l’augmenter. Si la résilience innée pouvait suffire à se dégager des causes des traumatismes, alors l’empathie des témoins lucides ne serait plus nécessaire. Je pense que l’indifférence à l’égard des mauvais traitements infligés aux enfants est déjà suffisamment grande, il n’y a pas besoin de la renforcer davantage.
Une sensation de solitude absolue
Les personnes éclairées sont toutefois toujours difficiles à trouver, même parmi les spécialistes. Par exemple, quelqu’un qui veut se renseigner sur la vie de Virginia Woolf et fait des recherches sur Internet tombe sur une page où des psychiatres de renom lui apprennent qu’elle était « malade mentale », et que cette affection n’avait aucun rapport avec la violence sexuelle à laquelle elle avait été soumise pendant des années au cours de son enfance. Bien que dans ses écrits biographiques, Virginia Woolf décrive de façon saisissante la terreur dans laquelle elle a vécu son enfance[7], en 2004, le refus d’établir une relation entre ces traumatismes lourds et ses dépression ultérieures est encore complet.
Il faut dire que de son vivant, on n’imaginait même pas qu’il puisse y en avoir une. L’écrivain qu’elle était lisait ses textes aux membres de son cercle littéraire, mais n’en restait pas moins seule, car la signification de ce qu’elle avait vécu étant petite lui échappait à elle autant qu’à son entourage, et même à son mari Léonard (comme en témoigne ce qu’il a écrit sur sa femme après sa mort). Elle était entourée de gens qui partageaient ses ambitions artistiques et les encourageaient, mais elle-même n’était pas en état de comprendre la sensation de solitude absolue qui resurgissait régulièrement. Cela peut finalement paver la voie au suicide, parce que le sentiment présent d’isolement rappelle en permanence l’abandon et la menace pour son existence vécus par le petit enfant.
Quand une prétendue maladie mentale a conduit quelqu’un au suicide, on lui trouve presque à chaque fois des causes génétiques. Les biographes décrivent la vie de leurs protagonistes dans tous ses détails, mais omettent le plus souvent d’accorder à l’enfance l’attention qu’elle mériterait.
Récemment est parue une riche biographie de Jean Seberg, que l’auteur Alain Absire a présentée sous la forme romanesque[8]. Elle a tenu le rôle principal dans 35 films, dont certains sont très connus, comme À bout de souffle. Manifestement, Jean Seberg avait montré dès l’enfance un intérêt très vif pour le théâtre, et elle avait beaucoup souffert de la rigidité morale d’un père protestant luthérien, qu’elle idéalisa par la suite. Alors qu’elle n’avait pas encore terminé sa scolarité, elle fut retenue pour son premier rôle au cinéma parmi des milliers de candidates, son père fut dans l’incapacité de se réjouir avec elle et ne sut que lui prodiguer des mises en garde. C’est ainsi qu’il se comportait chaque fois qu’elle connaissait un succès : au nom de son amour paternel, il lui faisait des sermons. Toute sa vie, elle fut incapable de s’avouer à quel point l’attitude de son père la blessait, et elle endura les tortures que lui faisaient subir les partenaires qu’elle se choisissait d’après un modèle déterminé.
Naturellement, on ne peut pas dire que le caractère de son père était la cause de sa vie gâchée. C’était son propre déni des souffrances causées par ce père-là qui entraînaient ses graves crises de dépression. Ce déni dominait sa vie et la conduisait à retomber régulièrement sous le pouvoir d’hommes qui ne la comprenaient pas plus qu’ils ne la respectaient. Elle répétait compulsivement ce choix de partenaire autodestructeur parce qu’elle ne voulait pas prendre conscience des sentiments que l’attitude de son père faisait naître en elle. Elle était incapable de trouver un partenaire satisfaisant, ou bien il lui fallait le quitter dès qu’elle en avait trouvé un qui n’avait pas avec elle un comportement destructeur. À quel point avait-elle donc dû désirer que son père la reconnaisse un jour pour tous ses succès… Mais il ne lui renvoyait que des critiques.
La mort au sommet de la réussite
Manifestement Jean Seberg n’avait pas la moindre idée du caractère tragique de son enfance, sinon elle ne serait pas devenue esclave de l’alcool et des cigarettes, et il ne lui aurait pas fallu se suicider. Elle partage son sort avec de nombreuses autres vedettes, qui ont espéré échapper à leurs sentiments véritables au moyen de drogues, ou dont la vie a été interrompue prématurément par une overdose, comme ce fut le cas pour Elvis Presley, Jimmy Hendrix ou Janis Joplin.
La vie (et la mort) de toutes ces vedettes au sommet de la réussite prouve bien que la dépression n’est pas une souffrance causée par le présent, qui tout au contraire leur a apporté la réalisation de quasiment tout ce dont elles ont pu rêver, mais une souffrance due à la séparation de leur propre soi, dont l’abandon précoce n’avait jamais pu être pleuré comme il l’aurait dû, et qui de ce fait n’a jamais pu vivre. Tout se passe comme si le corps utilisait la dépression pour protester contre cette infidélité à soi-même, contre le mensonge, contre cette coupure de ses véritables sentiments, parce qu’il ne peut tout simplement pas vivre sans sentiments authentiques. Il a besoin du libre flux des émotions, qui aussi se modifient constamment : fureur, tristesse, joie. Quand elles sont coincées dans la dépression, le corps ne peut pas fonctionner normalement.
Pour l’y contraindre malgré tout, toutes sortes de moyens sont utilisés : drogues, alcool, nicotine, médicaments, fuite dans le travail. Tout cela pour ne pas avoir à comprendre la révolte du corps, pour ne jamais risquer de découvrir que les sentiments ne nous tuent pas, mais peuvent au contraire nous libérer de la prison qui a pour nom dépression. Bien sûr, la dépression peut revenir si nous recommençons à ignorer nos sentiments et nos besoins, mais avec le temps nous pouvons apprendre à toujours mieux nous y prendre avec elle. Etant donné que les sentiments nous renseignent sur ce qui nous est arrivé dans notre enfance, nous pouvons comprendre ce qu’ils nous disent, nous n’avons plus à les craindre autant qu’avant, la peur diminue et nous sommes mieux préparés à faire face à une nouvelle phase dépressive. Toutefois, il ne nous devient possible de laisser libre cours aux sentiments que lorsque nous nous n’avons plus à craindre nos parents intériorisés.
Je suppose que l’idée que nos propres parents ne nous ont pas aimés est insupportable à la plupart des gens. Plus les faits s’accumulent et mettent en lumière cette déficience, plus les gens s’accrochent à l’illusion qu’ils auraient été aimés. Ils s’accrochent aussi aux sentiments de culpabilité, dont la fonction devrait être de leur confirmer que c’est bien à cause d’eux, de leurs erreurs et de leurs déficiences si leurs parents ne leur ont pas manifesté d’amour. Dans la dépression, le corps se rebelle contre ce mensonge. Beaucoup préfèrent mourir, ou mourir symboliquement en étouffant leurs sentiments, plutôt que de revivre l’impuissance du petit enfant que les parents utilisent pour servir leur orgueil ou pour projeter sur lui comme sur une cible leurs sentiments de haine accumulés.
La dépression ou le prix du renoncement à soi-même
Le fait que la dépression compte au nombre des maladies les plus courantes de notre époque n’est plus un secret parmi les spécialistes. C’est un sujet qui est souvent abordé dans les médias, où l’on discute de ses causes et des différents types de traitements. Dans la plupart des cas, on a l’impression que la seule chose qui compte, c’est de trouver la prescription médicale appropriée à chaque individu. Dans les milieux psychiatriques, on affirme aujourd’hui que des médicaments qui ne rendent pas dépendants et ne présentent pas d’effets secondaires ont enfin été mis au point. Du coup, le problème semble résolu. Mais pourquoi alors tant de gens se plaignent-ils malgré tout de souffrir de dépressions, si la solution est si simple ? Naturellement il y a des gens qui souffrent de dépression et qui ne veulent pas prendre de médicaments, mais même parmi ceux qui en prennent, il en est qui sont malgré tout toujours sujets à des accès de dépression, et que même des années de psychanalyse, différents types de psychothérapies ou des séjours en centre de soins n’ont pu aider à se libérer.
Qu’est-ce qui caractérise une dépression ? Avant tout l’absence d’espoir, la perte d’énergie, une grande fatigue, la peur, le manque de motivation, de centres d’intérêt. L’accès à ses propres sentiments est bloqué. Tous ces symptômes peuvent être présents ensemble ou isolément, même chez un individu qui de l’extérieur semble bien fonctionner, qui est même très productif au travail, qui éventuellement peut même avoir une activité thérapeutique et chercher à aider les autres. Mais à lui-même, il ne peut apporter aucune aide. Pourquoi ?
En 1979, dans Le Drame de l’enfant doué, j’ai expliqué comment certaines personnes réussissent à se tenir éloignées de la dépression grâce à des fantasmes de grandiosité ou à des actions extraordinaires, et comment cela peut justement se produire dans le cas de psychanalystes ou de thérapeutes qui apprennent dans leur formation à comprendre les autres, mais pas à se comprendre eux-mêmes. J’en ai cherché les raisons dans l’enfance de ceux qui choisissent ces métiers et montré qu’ils ont dû apprendre très tôt à ressentir la détresse de leurs pères et mères, et à y réagir tout en mettant de côté leurs propres sentiments et besoins. La dépression est le prix que paye l’adulte pour ce renoncement à être soi-même. Toujours, il s’est demandé en quoi les autres ont besoin de lui, et c’est ainsi qu’il en est venu non seulement à négliger ses propres sentiments et besoins originels, mais aussi à ne même pas les connaître. Mais le corps, lui, les connaît et insiste pour que l’individu puisse vivre ses véritables sentiments authentiques et se donne le droit de les exprimer. Pour des personnes qui ont été utilisées dès leur petite enfance pour les besoins de leurs parents, cela n’a cependant rien d’une évidence.
De cette façon, nombreux sont ceux qui au cours de leur vie perdent complètement le contact avec l’enfant qu’ils ont été. En fait, ils ne l’avaient jamais eu, mais avec l’âge, il leur devient encore plus difficile de l’établir. D’un autre côté, l’accroissement de la dépendance que l’âge impose au corps agit comme un rappel de la situation de l’enfant. On parle alors de dépression sénile, et l’on pense qu’il faudrait l’accepter comme quelque chose de naturel.
Mais il n’en est rien. Une personne qui connaît son histoire n’est pas obligée de devenir dépressive avec l’âge. Et si elle traverse des phases dépressives, il lui suffit de laisser ses sentiments authentiques s’exprimer pour les faire disparaître. Car à tout âge, la dépression n’est rien d’autre que la fuite devant la masse des sentiments que les blessures de l’enfance pourraient faire remonter. C’est ce qui crée un vide intérieur chez la personne touchée. Quand il faut éviter à tout prix les souffrances psychiques, il n’y a finalement pas grand-chose qui soit capable de maintenir la vitalité. Des prestations hors du commun sur le plan intellectuel peuvent aller de pair avec une médiocre vie intérieure d’enfant sous-développé émotionnellement. Cela est vrai à tout âge.
L’enfance royale de Louis II de Bavière
La dépression, qui reflète ce vide intérieur, est, je le répète, le résultat de l’évitement de toutes les émotions qui sont reliées aux blessures précoces. Cela conduit à ce qu’une personne dépressive ne soit pour ainsi dire pas capable d’éprouver des sentiments conscients, à moins que, déclenchés par un événement extérieur, il ne soit débordé par des sentiments qui restent totalement incompréhensibles, parce que l’histoire véritable et non idéalisée de son enfance lui est inconnue, et qu’il vit cette irruption des sentiments comme une catastrophe soudaine.
Les patients qui séjournent dans un centre de santé mentale s’entendent toujours dire qu’ils n’ont pas à aller fouiller dans leur enfance, qu’ils n’y trouveront pas de réponses et qu’ils feraient mieux de se décider à tout oublier pour trouver leurs marques dans la nouvelle situation. Rien n’est plus éclairant que les efforts qui sont faits pour éviter tout ce qui pourrait jouer sur les nerfs des patients, ce qui conduit à interdire les visites des proches. Le point de vue selon lequel de telles rencontres, justement parce qu’elles ont un effet émotionnel fort sur le patient, peuvent le stimuler (car les émotions ne sauraient avoir un effet nuisible, mais bien au contraire bénéfique), n’est la plupart du temps toujours pas accepté dans ces centres. On peut ressentir les effets tragiques que ce type de prescriptions provoque parfois dans la vie des individus à la lecture de la correspondance entre le poète Paul Celan et sa femme. On lui interdisait de façon stricte de recevoir sa visite, ce qui renforçait encore son isolement et sa maladie.
Dans le cas du roi Louis II de Bavière, nous avons affaire à une façon spectaculaire de crier inconsciemment sa solitude à la face du monde et de raconter ce qu’a été son enfance. Ce roi a construit des châteaux fastueux qu’il n’a jamais habités. Dans l’un, il a passé en tout onze jours, et il n’a jamais séjourné dans les autres. Ces merveilleux châteaux ont été construits avec beaucoup de soin et d’après les principes de la technique la plus moderne. Aujourd’hui, ils sont visités par des foules de touristes, admirés par certains, suscitant les sourires de ceux qui n’y voient que du kitsch, tandis que qu’un petit nombre les considère comme le fruit bizarre d’un esprit malade. Car de son vivant déjà, la « schizophrénie » avait été diagnostiquée chez Louis II, un diagnostic qui est toujours considéré comme juste aujourd’hui et qui en fait n’explique rien. Ou alors, c’est dire que ce comportement aberrant a pour cause une maladie génétique et qu’il est donc vain de chercher à lui donner un sens.
Munis de ces informations trompeuses, les visiteurs passent d’une salle à l’autre, dans ces luxueux châteaux qu’un roi « malade » fit construire avec l’argent de ses sujets. Et jusqu’alors, personne ne semble s’être posé la question : Que s’est-il passé au seuil de cette vie royale ? Pourquoi cet homme construisait-il des châteaux dans lesquels il n’habitait pas ? Que voulait-il dire par là ? Voulait-il raconter une histoire que son corps avait mémorisée et qu’il connaissait bien, mais que sa conscience devait écarter parce qu’il est interdit d’accuser ses propres parents ?
Louis II, le premier-né, a été soumis dès sa naissance à une éducation rigide qui fit de lui un enfant solitaire, assoiffé d’amour et de contact. Le point-clé, c’est que ces besoins les plus élémentaires étaient négligés d’une façon ahurissante. Cet enfant très sensible ne trouve pas sa place auprès de parents qui le jugent bête et laissent les domestiques s’occuper de lui. C’est auprès d’eux que le garçon reçoit le pain qu’on lui refuse au château pour qu’il apprenne à discipliner sa faim. Que de telles méthodes d’éducation soient tout simplement sadiques et renvoient donc à l’enfance de ses parents, l’enfant ne peut pas le comprendre. Même si l’adulte devait le comprendre un jour, cela ne lui servira pas à grand-chose, parce que ce que son corps veut, c’est que les émotions enfouies et les véritables sentiments refoulés puissent être retrouvés. Mais de toute sa vie, cela ne fut pas possible à Louis II : d’où ce comportement aberrant, appelé schizophrénie. Le roi respectait ses parents, comme il se doit. Il ne s’autorisait jamais à laisser monter en lui son sentiment de frustration et, plus âgé, ne dirigeait jamais sa colère vers d’autres cibles que des domestiques. Son incapacité à exprimer son impuissance, alors même qu’il était condamné à être privé de nourriture dans un cadre de vie luxueux, l’a amené à ne plus pouvoir ressentir autre chose que de la peur.
C’est cette peur qui fut à l’origine de la solitude qui fut la sienne à l’âge adulte. Il fuyait les gens, était poursuivi par des cauchemars, vivait dans la crainte d’une agression soudaine. Il est extrêmement vraisemblable que cette crainte puisse être rattachée à des événements réels vécus dans l’enfance. Car Louis II vivait sa sexualité en secret, il se faisait envoyer des photos de beaux jeunes gens qui croyaient avoir été choisis comme modèles de nus par des artistes. Mais une fois dans les appartements du roi, celui-ci abusait d’eux. De tels abus, une telle tromperie sont inconcevables si l’abuseur n’a pas été lui-même abusé. On est donc porté à en conclure que Louis II a subi des violences sexuelles dans son enfance. Rien n’impose que cela se soit nécessairement produit dans le cercle familial. Par les mémoires d’Heroard, médecin de la cour de France, nous sommes en effet renseignés sur ce que le roi Louis XIII a pu subir de la part de la domesticité quand il était enfant[9].
Parents distants et impitoyables
Tout cela n’aurait pas nécessairement mené à la « schizophrénie » si au cours de son adolescence il s’était trouvé quelqu’un pour aider le jeune Louis à voir quelle était sa situation, à déceler tout ce qu’il y avait de cruel dans le comportement de ses parents, à s’y opposer ou à tout le moins à s’avouer sa colère, ou encore à s’interroger plus tard avec lui à propos de ce que ses projets de châteaux remuaient en lui. Il est possible qu’il ait voulu inconsciemment donner forme par sa créativité à quelque chose qu’il lui était interdit de penser consciemment: le fait qu’enfant, malgré le grand luxe qui l’entourait, il ait dû vivre comme un moins que rien. Pour ses parents, son existence ne comptait pas, ils ne reconnaissaient pas ses capacités (le père ne le considérait pas comme assez intéressant pour le prendre avec lui dans ses promenades) et ne le nourrissaient même pas suffisamment, si bien que de temps en temps, il devait aller chez des paysans en dehors du château pour manger à sa faim.
Parmi les très nombreux documents que l’on trouve sur Internet à son sujet, voici ce que l’on peut lire sur son enfance :
« La façon de vivre des deux princes était très simple. Parmi d’autres singularités, la bonne éducation de l’époque imposait de ne pas laisser les enfants manger à leur faim, et le futur roi était très content quand la fidèle servante Lisi et les laquais lui rapportaient parfois à manger de la ville, ou lui donnaient un peu de leur nourriture, plus abondante que la sienne.
« S’il arrive que les jeunes princes fassent une bêtise de leur âge ou viennent à manquer à un de leurs devoirs, ils sont impitoyablement punis. Par cette éducation sévère, leur père, le roi Max II, veut faire de ses fils des princes capables et travailleurs. […]
« Max II n’arrive pas à établir une relation de confiance avec ses fils, particulièrement avec le prince héritier, dont la nature est très différente de la sienne; il se sent profondément étranger à ses préoccupations et montre peu d’intérêt pour son développement. Voici ce que raconte à ce propos dans ses souvenirs Franz von Pfistermeister, qui fut pendant de longues années le secrétaire de cabinet de Max II, puis de Louis II : “Le roi ne voyait ses deux petits garçons, les princes Louis et Otto, qu’une à deux fois par jour, le midi au deuxième déjeuner et le soir à table au souper, fort rarement dans les pièces où se déroulaient leur vie et leur éducation. À ces occasions, il se contentait en général de leur présenter sa main pour le salut et prenait congé au plus vite. Alors que le prince héritier approchait déjà de sa majorité, de longs et importants efforts de conviction avaient été nécessaires pour amener le roi à prendre avec lui son fils aîné lors de sa promenade matinale dans le jardin anglais (de 9 à 10 heures). Cela ne se reproduisit cependant que quelques fois. Le roi déclara : ‘Pourquoi me faut-il parler avec ce jeune monsieur? Il ne porte intérêt à rien de ce que je projette’.”
« Le souvenir des situations d’échec vécues tout au long de ces années d’éducation et de la froideur des rapports avec son père a pesé sur Louis toute sa vie. À 30 ans, il écrit au prince héritier Rudolf d’Autriche : “Tu peux t’estimer très heureux d’avoir joui d’une éducation en tous points excellente et empreinte de compréhension, de surcroît, c’est une chance que l’empereur s’intéresse personnellement avec tant d’ardeur à ta formation. Avec mon père, il en est malheureusement allé tout autrement, il m’a toujours traité de haut en bas [en français dans le texte, NDT], et tout au plus honoré de quelques mots froids et protecteurs en passant. Cette curieuse façon de faire, tout comme ses autres méthodes éducatives, était appréciée de lui pour la raison singulière que son père en usait de même”.
« Sa mère, la reine Marie, qui fut dans sa jeunesse une beauté admirée, est une femme facile à vivre, mais limitée, et qui ne s’intéresse en rien aux choses de l’esprit. Paul Heyse, l’un des membres du cercle de poètes munichois réuni autour de Max II, disait d’elle : “Malgré bien des tentatives, tous les efforts pour éveiller chez la reine un intérêt pour la littérature et la poésie échouèrent. Elle ne se trouvait à son aise que dans les bavardages et les conversations faciles…”
« La reine Marie ne sait pas très bien s’y prendre pour gagner le coeur de ses enfants. Franz von Pfistermeister raconte dans ses mémoires : “La reine elle aussi s’y entendait fort peu pour attirer vers elle ses petits princes. Certes elle leur rendait visite plus souvent dans leurs appartements, mais elle ne savait pas se comporter avec eux comme les enfants l’attendent. Cela non plus n’attirait pas les garçonnets vers leur mère”. »
Un peintre désespéré
Même quand on a connaissance d’éléments précis de l’enfance d’une personne, il est très rare que l’on établisse un rapport avec les souffrances de l’âge adulte. On parle d’une destinée tragique, sans chercher à en comprendre la nature. Il ne semble pas y avoir eu dans la vie de Louis II quelqu’un qui l’ait et se soit interrogé sur le sens profond que les châteaux avaient pour lui. Aujourd’hui encore, malgré un grand nombre de films sur le « pauvre » roi, il ne s’est manifestement trouvé personne pour rechercher dans son enfance le moment où cette prétendue « schizophrénie » a pris naissance. Pendant ce temps, de nombreux scientifiques étudient consciencieusement tous les détails de ses réalisations architecturales et leur consacrent des livres. Le produit final d’une folie suscite un grand intérêt. Mais sa naissance est entourée d’un profond silence, parce que nous ne pouvons pas comprendre la genèse de cette maladie sans mettre à jour le manque d’amour et la cruauté des parents. Et cela rend la plupart des gens malades, parce que cela pourrait leur rappeler leur propre sort.
C’est la peur qu’éprouvent les enfants bafoués ou même tyrannisés devant le visage véritable, sans fard ni masque, de leurs parents, la peur qui nous entraîne vers l’automystification, et partant, vers la dépression. Ce n’est pas uniquement l’individu isolé, mais la quasi-totalité d’entre nous, toute la société, qui croit que les médicaments ont résolu le problème une fois pour toutes. Mais comment cela se pourrait-il ? La plupart des personnes dont j’ai évoqué le suicide prenaient des médicaments, mais leur corps ne se laissait pas tromper et refusait une vie qui au fond n’en était pas une. La plupart des gens gardent l’histoire de leur enfance profondément enfouie dans leur inconscient et ont du mal, s’ils ne sont pas accompagnés, à établir le contact avec leurs souvenirs originels, même si ils le veulent. Ils n’ont pas d’autre choix que de se faire aider par des spécialistes pour qu’il leur apparaisse qu’ils se sont raconté des histoires, et pour se libérer de la morale traditionnelle. Pourtant si les spécialistes ne font rien de plus que de prescrire des médicaments, ils contribuent à consolider la peur, et de surcroît rendent encore plus difficile l’accès à ses sentiments propres, dont les potentialités libératrices restent inutilisées.
Pour ce qui me concerne, c’est surtout à la peinture spontanée que je dois mon éveil. Mais cela ne veut pas dire que la peinture pourrait être recommandée comme une recette pour soigner la dépression. Nicolas de Staël, dont j’admirais beaucoup autrefois le talent, a peint dans les six derniers mois de sa vie 354 grands tableaux. Il se consacrait avec ardeur à son oeuvre, à Antibes, séparé de sa famille, et puis « il s’est précipité dans la mort depuis la terrasse qui avait été son atelier pendant ses six derniers mois[10] ». Il avait alors 40 ans. Son talent, que tant de peintres lui enviaient, ne l’avait pas préservé de la dépression. Peut-être quelques questions auraient-elles suffi à l’amener à réfléchir sur lui-même. Sa peinture, son talent, n’avaient jamais été reconnus par son père, qui avant la révolution russe avait été général. Il se peut que de Staël ait espéré, dans son désespoir, qu’il réussirait un jour à peindre le tableau capital, celui qui lui apporterait la reconnaissance de son père et son amour. Il est possible qu’il y ait un rapport entre ce besoin irrépressible de multiplier les productions à la fin de sa vie et cette détresse. Seul de Staël lui-même aurait pu le découvrir, si les questions capitales n’avaient été impossibles à poser. Alors il aurait peut-être pris conscience du fait que l’appréciation du père n’est pas déterminée par la qualité de la création du fils, mais uniquement par la capacité du père à se rendre compte de la qualité d’un tableau.
Ce qui a été capital dans mon cas, c’est que je me suis toujours posé de telles questions. Je me suis fait raconter mon histoire disparue par mes tableaux, plus exactement par ma main toute seule, elle qui de toute évidence savait tout, mais attendait que je sois prête à ressentir avec le petit enfant en moi. Et alors j’ai vu tout à coup cet enfant qui était utilisé par ses parents, mais qui n’était jamais vu, considéré ou encouragé, et qui devait cacher profondément sa créativité pour ne pas se faire punir en plus à cause d’elle.
Il ne faut pas analyser les tableaux de l’extérieur. À un peintre, cela n’apporterait pas grand- chose. Pourtant, ses propres tableaux peuvent réveiller chez lui des sentiments. S’il est en état de les vivre et de les prendre au sérieux, il pourra se rapprocher de lui-même et passer par-dessus les barrières de la morale. Alors, il lui sera possible de se confronter à son passé et à ses parents intériorisés, et de se comporter avec eux autrement qu’auparavant. À partir de sa conscience en développement et non plus de sa peur enfantine.
En effet, si je peux ressentir ce qui me fait mal et ce qui me fait plaisir, ce qui me contrarie ou même me met en colère et pourquoi ; si je sais de quoi j’ai besoin et ce que je ne veux en aucun cas, alors je me connais assez bien pour aimer ma vie et la trouver intéressante, indépendamment de mon âge et de mon statut social. Alors il est fort peu vraisemblable que survienne le besoin d’en finir avec la vie, à moins que le processus de vieillissement, un affaiblissement croissant du corps, ne suscitent de telles pensées. Mais dans ce cas, un être humain sait aussi qu’il a vécu sa vraie, sa propre vie.
Alice Miller*
Traduit de l’allemand par Pierre Vandevoorde
© Alice Miller, avril 2005
*Disparue en 2010, la psychothérapeute Alice Miller nous laisse une abondante bibliographie sur l’influence de l’enfance dans la vie de l’adulte, notamment Libres de savoir ou encore Notre corps ne ment jamais. Son œuvre est entièrement consacrée à l’étude des conséquences des traumatismes d’enfance. Elle a étudié plus particulièrement l’influence de la Pédagogie noire sur l’agressivité et la violence déployées par la suite par les jeunes gens et adultes. Ses ouvrages montrent aussi comment les punitions corporelles, en inculquant aux enfants l’idée que la violence peut être bonne si elle leur est infligée « pour leur bien » déstabilisent leur psychisme en profondeur.
Le corps et la morale
L’apparition de maladies graves est plus fréquente chez les personnes ayant été maltraitées pendant leur enfance. Pour retrouver l’intégrité de sa santé, l’adulte doit se libérer de l’attachement qu’il éprouve à l’égard de ses parents abusifs.
(01/2004)
Notes :
[1] Elsbeth Wolffheim, Anton Tchekhov, éd. Rowohlt 2001, p. 13.
[2] Ibid., p. 14.
[3] Ibid., p. 15.
[4] J’ai abordé ce point de façon plus complète dans Notre corps ne ment jamais, éd. Flammarion, 2004, pp. 37-41.
[5] Ivan Bounine, Tchekhov, éd. Le Rocher, 2004, p. 23.
[6] Citation extraite de l’édition française.
[7]) Lire Virginia Wolf, Augenblicke. Skizzierte Erinnerungen, Fischer Taschenbuchverlag, 1993.
[8] Alain Absire, Jean S., éd. Fayard, 2004.
[9] Alice Miller, L’Enfant sous terreur, éd. Aubier 1986. pp. 153-159.
[10] Nicolas de Staël, éd. du Centre Pompidou, 2003.